- Decameron Libero
- 7 likes
- 1549 views
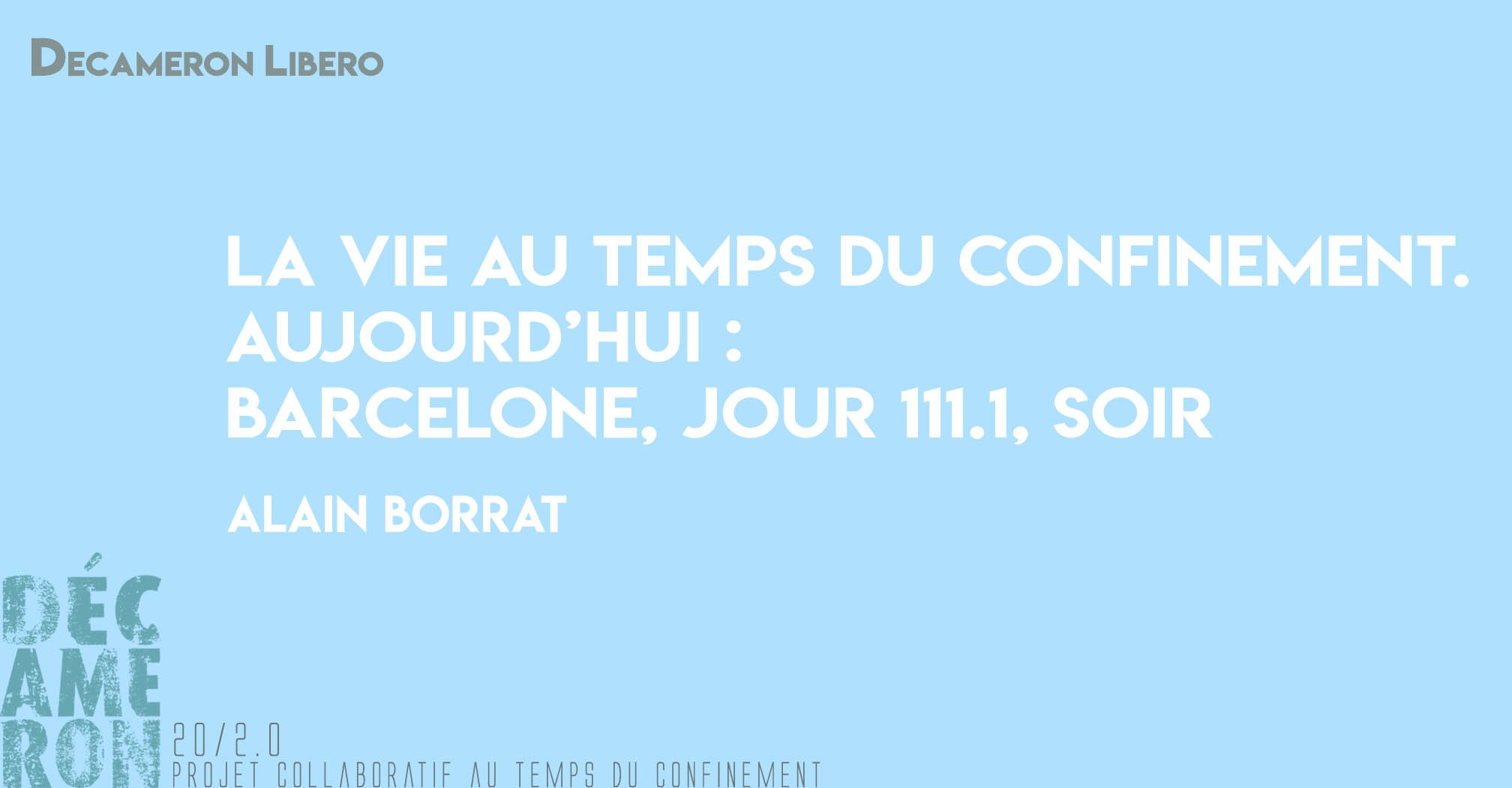
Les événements se précipitent… livré à lui-même le héros décide de… se sauver ! Fin de la série d’Alain Borrat.
La vie au temps du confinement.
Aujourd’hui : Barcelone, Jour 111.1, soir
Résumé des épisodes précédents :
Le Jour 100.0 du confinement, le Conseil Sanitaire de Guerre a décrété la Loi d’Ouverture Limitée (LOL) qui permet aux habitants d’effectuer une promenade de santé autour de leur domicile au jour correspondant à leur catégorie d’âge. Pour notre héros, cette sortie n’est pas une réussite…
Raconter le déroulement de tous les événements qui se sont déroulés ces derniers jours équivaut à tenter de démêler une pelote de fils solidement noués entre eux. Tout est allé tellement vite ! On ne me tiendra pas rigueur, j’espère, de ne pas m’en tenir à une narration totalement exacte du point de vue de la chronologie des faits.
De ma première sortie de déconfinement, j’étais remonté avec cette tragique constatation qu’être en vie était devenu risqué. J’avais vécu de tout mon corps – et avec quelle intensité ! –, comment désormais j’avais peur de tout ce qui n’est pas moi. Je m’installais alors dans cette idée guère glorieuse et porteuse de peu d’espoirs que mon domicile était l’unique endroit garant de ma sécurité et de ce qu’il me restait encore d’intégrité mentale. Par conséquent, j’étais disposé à subir encore des semaines et des semaines de réclusion, avec pour toute ouverture mon coin de rideau d’où jeter des regards sur l’extérieur terrifiant.
Il était impossible de prévoir ce qui allait se passer et qui entraînerait une avalanche de conséquences collectives et personnelles.
Si je me réfère aux notes que je continuais à consigner avec régularité dans mon cahier noir, le premier signe d’un dérèglement a été observé le Jour 105, soit le lendemain de mon effroyable promenade de santé. À l’instar, je suppose, de la plupart des habitants, j’étais sur le qui-vive à treize heures pour écouter le bulletin d’informations. Lors de la proclamation de la LOL, le CSG avait promis qu’après les cinq premiers jours de rotation de l’ouverture limitée, serait décidée ou non la reconduction du dispositif. Alors, qu’en sera-t-il ?
À l’heure habituelle, le générique des infos n’a pas résonné dans ma cuisine. J’ai laissé toute la place à un vide sonore au-delà des dix minutes réglementaires. La suite du programme, c'est-à-dire la retransmission des grandes épopées de notre football national, n’est pas non plus apparue.
Panne de courant, ou de mon transistor ? Accentuation soudaine de ma surdité sélective ? On se pose des questions, forcément. Après vérification, cela ne provenait pas de l’alimentation électrique.
J’ai bien vite été rassuré quant à la seconde hypothèse. Un rythme scandé semblait provenir de la Place. Les balcons, beaucoup de balcons étaient occupés par les hommes et les femmes du voisinage. Il était en train de se jouer la même scène que le soir de la prise de pouvoir du CSG (*) : les habitants tapaient sur des ustensiles sonores en reprenant à gorge déployée : « Libertad ». Je me suis muni d’une louche et de ma plus grosse gamelle et je me suis joint au concert : Libertad ! Libertad ! Ce tintamarre vigoureux paraissait effrayer les goélands, dont plusieurs s’envolaient de la Place en direction des rues avoisinantes. Je n’ai pas réussir à savoir si de leurs ailes ils se bouchaient les oreilles.
C’était une sensation curieuse que je ressentais, un peu comme un Jour 60 à l’envers. Taper sur nos gamelles n’exprimait pas comme ce soir-là le trop-plein d’enfermement et le besoin de liberté. Il s’agissait plutôt d’un cri de délivrance, que ça y était enfin, le bout du cauchemar. Libertad ! La Libération ! C’est ce que je crois avoir saisi pendant que je battais le rythme et que je regardais les balcons voisins en reprenant ce nom Libertad.
L’électricité a été coupée dans le milieu de l’après-midi et ce jour-là il n’y a pas eu d’eau du tout. Ni les jours suivant. Le lendemain, la caisse d’alimentation n’a pas été livrée. Plus rien ne fonctionnait, il n’y avait plus rien de la part du Conseil Sanitaire de Guerre et de ce qui pouvait encore s’appeler l’État. Plus plus rien.
Pour l’eau, ça pourrait aller, j’avais pour quelques jours de réserve dans les bassines. Concernant l’électricité, ce n’était finalement pas si dérangeant : depuis des semaines, je me passais de l’aspirateur et du fer à repasser, même de la machine à laver. C’était le moment, le soir venu, d’utiliser mon stock de bougies.
En revanche, ce qui allait rapidement devenir problématique, c’était l’alimentation. À présent que les livraisons n’avaient plus lieu, il faudrait trouver d’autres sources d’approvisionnement, ce qui semblait très compliqué. J’ai fait l’inventaire de ce qui me restait et j’ai bien dû me rendre à l’évidence qu’avec un paquet de nouilles à moitié entamé et deux boîtes d’olives je n’irais pas bien loin. Peut-être, ai-je pensé, qu’étant donné les circonstances nouvelles, quelques commerces avaient rouvert, à commencer par les boulangeries. Il y en avait deux à cinq minutes de mon domicile, dans la grande rue.
J’ai mis longtemps à me préparer. Pas tant pour ce qui était de mon habillement et des indispensables masque et gants de protection que mentalement. J’avais une expérience toute récente et elle m’avait profondément marquée. Il faudrait traverser l’odeur infâme et se protéger des goélands avant d’atteindre le check-point puis de déboucher sur la grande rue. Cette fois-ci, j’ai songé à couvrir mes cheveux d’une casquette. On apprend vite.
Je suis sorti. J’ai marché droit devant moi du pas le plus rapide que pouvaient m’autoriser mes jambes affaiblies. C’était une épreuve pour laquelle je suis allé puiser au fond de ma volonté pour surmonter le dégoût et les bataillons d’oiseaux blancs. Ça bouchonnait un peu au check-point. Des personnes venaient d’un sens, d’autres du sens inverse voulaient sortir, et comme l’étroitesse du couloir tracé par les sacs de sable ne permettait le passage que d’une seule personne à la fois, il a fallu que j’attende mon tour. Au-dessus des masques, les regards lançaient à la dérobée des œillades de suspicion. Comme dans cette chanson de Vassiliu : « Qu’est-ce qu’il fait Qu’est-ce qu’il a Qui c’est ce type là ? ». J’avais une conscience très vive que pour les quatre hommes et les deux femmes qui me précédaient dans la file d’attente du check-point, j’étais autant « ce type là » qu’ils l’étaient pour moi. Un potentiel danger. De façon spontanée, je dirais devenue naturelle, nous attendions notre tour éloignés d’environ deux mètres les uns des autres. Aucun mot ne fut prononcé entre nous bien que la veille nous chantions sans doute ensemble Libertad depuis nos balcons.
La grande rue commerçante, près de deux mois après ! Nul véhicule n’y circule, premier constat. À première vue les magasins sont clos, certains fermés par des rideaux métalliques. Je n’ai pas longtemps à hésiter entre la boulangerie du côté gauche et celle du côté droit car un attroupement attrape mon regard, à droite et sur le trottoir d’en face au niveau de la supérette, une petite foule bruyante dont je m’approche.
Soudain le brouhaha est recouvert par le crissement d’un métal déchiré. L’explication saute aux yeux : trois hommes munis de pieds-de-biche viennent de soulever en le détruisant en grande partie le volet gris de la supérette. Aussitôt c’est la ruée, l’empressement général. Je reste un moment sur le trottoir, trop craintif encore pour me joindre à cet amas humain soudain pris d’une frénésie que je juge dangereuse. Des hommes et des femmes se bousculent pour entrer, on a amené des enfants. Certains sortent bientôt de la supérette les bras chargés de paquets, de bouteilles, d’emballages sous vide. Les mieux organisés ou les plus rapides utilisent les caddies de la supérette, d’autres les paniers rouges. Je me décide enfin, il faut bien que moi aussi je me procure quelque chose à manger.
Une voix de femme se dégage de la cohue. Une trentaine d’années, son masque descendu au niveau du menton, elle est juchée sur le tapis roulant immobile de l’une des caisses. « Mes amis, mes amis, nous ne pouvons pas nous comporter de cette façon. Nous ne pouvons pas penser à nous et seulement à nous. Il faut nous organiser. Je propose que les personnes avec enfant commencent à… ». Elle n’a pas l’occasion de continuer sa harangue car voici qu’un grand costaud lui enserre les jambes dans le creux de son coude, lui faisant perdre l’équilibre. Il l’insulte copieusement. Elle est par terre, elle est tombée sur l’épaule et semble avoir mal. Nous sommes plusieurs à nous approcher pour tenter de la relever. De nouveaux arrivants viennent de la rue en courant. Nous bousculent. Plusieurs piétinent sans la voir la femme qui voulait faire appel au sens de la responsabilité et de l’organisation collectives.
On me pousse, on me fait avancer que je le veuille ou non. Ça crie, ça hurle des prénoms et des noms de produits alimentaires. C’est le pillage, c’est la mise à sac de la supérette. Deux hommes se battent à l’intérieur du rayon charcuterie. Des gamins remplissent leurs poches de barres chocolatées. Des femmes et des hommes de tous âges accumulent toutes sortes de produits dans les paniers rouges. Je me saisis comme je peux de deux paquets de biscuits et d’un litre d’une boisson sucrée. Sortir, vite. La jeune femme est maintenant entourée de deux personnes, dont l’une semble être médecin ou infirmière. On l’a assise contre un mur dans un recoin de l’entrée. Je rentre chez moi avec mes maigres courses.
Je n’ai aucun doute sur le fait que la scène de la supérette a été en grande partie le facteur qui a déclenché ma décision.
Si j’avais assimilé depuis longtemps que le confinement était un sport de combat, le peu que j’avais vu de « la vie d’après » signifiait une lutte sans merci dans laquelle tous les coups semblaient permis. La loi de la jungle, c'est-à-dire celle du plus fort ou du plus rusé. Oui, vraiment, être en vie était risqué. En tous cas ici, dans la ville. Est-ce partout ailleurs de cette façon que les relations humaines sont en passe de devenir ? Les gens comme les goélands ont faim.
Notre civilisation saura-t-elle assurer sa sauvegarde ou bien les notions de partage et d’entraide ont-elles déjà disparu? Il est probable qu’un régime militaire autoritaire et sans pitié profite de cet état de chaos pour imposer son ordre et ses lois rigides aux habitants. Cela commencera, c’est sûr, par un retour au strict confinement. C’est sans issue.
Ou bien, alors que des petites communautés de voisins, des îlots ici ou là, parviennent à trouver des moyens de coopérer pour assurer une distribution des vivres équitable et qui corresponde aux besoins de chacun. Mais les magasins seront bientôt totalement vidés. Comment produire vite et suffisamment ?
Telles étaient quelques unes des réflexions qui ont tourné sans trêve dans ma tête pendant plusieurs jours et autant de nuits. Ça faisait un sacré grabuge dans mon ciboulot. Trouver le sommeil, c’était mission impossible. J’avais versé tout mon stock de gélules bleu et rose dans un sachet à ordure et l’avais balancé par la fenêtre. Peut-être cela calmera la faim de quelques goélands et leur permettra de se reposer un peu, je m’étais imaginé.
Le premier acte de ce que je peux appeler mes préparatifs a été de me raser. Totalement. Barbe et cheveux. Il a bien fallu que j’ouvre la porte de la salle de bain et que je me retrouve nez à nez avec moi-même. Pas vraiment beau à voir, j’étais devenu après cent dix jours de confinement. Surtout, c’était les yeux. D’abord parce que de mon visage je ne voyais plus que ça, mes yeux et mon nez. Le reste était recouvert de poils hirsutes gris et blancs. Mes yeux, leur noirceur, apportaient à cet enchevêtrement pileux un contraste saisissant. Je constatais qu’ils avaient comme doublé de surface. De surface, pas de volume. Ils constituaient la partie brillante d’une zone noire dessinée par les cernes foncées qui avaient envahi la partie visible de mon visage en-dessous des sourcils.
J’ai taillé dans le vif et n’importe comment avec ce que j’avais de plus grand comme paire de ciseaux. Chlaf chlaf chlaf chlaf en dépit du bon sens. J’ai repensé à Ana la coiffeuse qui mettait un soin méticuleux à égaliser mes mèches. La serviette dont j’avais recouvert le lavabo s’est rapidement remplie d’un monceau de poils et de cheveux qui faisait comme un écheveau couleur de neige sale.
Une fois le plus gros débroussaillé, j’ai enchaîné avec la tondeuse. Depuis des mois qu’elle somnolait sur son socle, sa batterie était pleine à ras bord d’électricité. Vroum et vroum et vroum. Ensuite, j’ai tout enduit de mousse et le fignolage je l’ai pratiqué au rasoir manuel, les joues et le cuir plus du tout chevelu. C’était la première fois que je me rasais le crâne.
J’ai vécu cette activité à la fois comme une expérience émouvante et une entrée dans un âge nouveau. Un sérieux rinçage avec de l’eau de bassine puisée à l’aide d’une casserole a conclu l’opération. Du bon boulot, j’ai dit à haute voix en m’adressant à mon portrait dans le miroir. Mes oreilles me semblaient avoir grandi un peu depuis la dernière fois, je n’ai pas voulu les mesurer. Je redécouvrais que j’avais un menton.
J’ai occupé le reste de la journée à préparer les objets dont j’aurais besoin. À commencer par donner un coup de propre à mon vieux sac à dos vert enfoui dans un placard depuis des années. Il me faudra des vêtements chauds car j’aurai sans doute à affronter des nuits fraîches. Une paire d’espadrilles dans lesquelles reposer mes pieds, le soir. Mon duvet et mon couteau, bien sûr. Deux stylos, une lampe frontale. Mon passeport, on ne sait jamais. Pour la carte bancaire j’ai hésité, ne sachant si l’argent était encore d’usage. J’ai finalement décidé de l’emporter, ça ne prend pas de place. Le paquet de biscuits qui me restait, une gourde que j’ai remplie à la dernière bassine.
Je partirai demain avant le lever du soleil. De nuit ça me semble plus prudent.
Une fois déposés mes chaussures de marche, ma casquette et mon cahier noir en évidence au pied de la porte pour ne pas les oublier, je me suis plongé dans les cartes géographiques de la région.
Je ne cache pas que j’ai eu du mal à imaginer où je pourrais aller. L’essentiel n’était pas tant d’avoir un objectif que de m’en aller. J’irai vers le nord, vers les montagnes. Là-haut, peut-être qu’un village m’accueillerait où je n’aurais qu’à prononcer mon nom pour trouver un gîte et de quoi me restaurer. Est-il encore habité, ce village montagnard ? M’y recevra-t-on ? Sur le chemin, je pourrais faire escale dans une petite ville où j’avais des amis. Leur numéro de téléphone est chose inutile, j’ai seulement le souvenir de la photo d’une haute maison blanche aux volets peints en jaune avec un bout de pelouse et quelques arbres sur le devant. Je ne suis pas certain d’être capable de sujets de conversation.
J’ai tout laissé, tout. Toutes ces centaines d’objets que j’avais achetés, dénichés, conservés, accumulés, entretenus, caressés depuis les débuts de ma vie d’homme et qui m’avaient si souvent nourri. Et ceux que l’on m’avait offerts. Ma culture et mes références, comme j’aimais appeler. Juste avant de boucler mon sac à dos, j’ai cherché un livre dans la bibliothèque. Il en faudra tout de même un, un seul. Si je devais amener un livre sur une île déserte… C’est le titre qui m’a immédiatement fait sortir celui-ci du rayonnage pour le glisser dans une poche latérale de ma besace : Cent ans de solitude, c’était particulièrement indiqué. Je l’avais déjà lu trois fois mais j’aurais certainement encore à y puiser. Moi, je n’en étais qu’à cent dix jours, un bon début.
J’ai laissé la clé à l’intérieur de mon appartement, j’ai refermé la porte d’entrée derrière moi et puis j’ai descendu l’escalier. J’ai espéré très fort que je n’aurais jamais à regretter cet instant présent. Je partais pour un voyage que je voulais sans retour.
Dans le jour naissant à peine, j’ai remarqué que les oiseaux blancs étaient moins nombreux. Effet des gélules ou migration vers d’autres lieux d’alimentation ? J’ai traversé les remugles de la Place sans le moindre état d’âme ni regard en arrière puis j’ai emprunté des enfilades de petites rues. Je tenais beaucoup à éviter des rencontres. À certains endroits, le spectacle était d’une désolation consternante. Des milliers d’éclats de verre jonchant le trottoir signalaient qu’ici un magasin avait été dévalisé jusqu’à la dernière miette. Il y en avait beaucoup comme ça, des débris de verre et des volets métalliques arrachés. Je traversais des places présentant la même dévastation que la mienne, sacs bleus, os, oiseaux, puanteur infecte.
Mon itinéraire pour quitter la ville était parfaitement précis : avancer plein ouest pour rejoindre la chaîne montagneuse qui surplombe. Une fois que j’y serai parvenu, je croiserai bien quelque chemin. Je prendrai alors à droite en direction du nord.
***
Il fait encore un peu jour. Je suis fatigué, j’ai mal aux jambes, j’ai mal aux pieds, j’ai marché toute la journée. D’un pas lent mais que je peux qualifier de décidé. Lorsque le soleil commençait à se lever, j’ai franchi la très longue avenue qui, telle une flèche démesurée, coupe la ville en diagonale. J’ai marqué une pause assez longue au milieu, là où autrefois circulaient les véhicules, pour observer une demi-douzaine de sangliers qui fouillaient avec leurs groins volontaires et désordonnés les plates-bandes et des parcelles de gazon. Plus loin, dans une rue qui précède les premières montées, j’ai profité de la vitrine éclatée d’une alimentation de quartier pour me servir en noix et en fromage en tranches à la date de consommation périmée. C’est tout ce qu’il restait, c’est déjà ça.
Vue d’en-haut, la ville paraissait avoir son aspect habituel, constitué de ses bâtiments caractéristiques et la mer là-bas au bout. De plusieurs endroits s’élevaient d’épaisses fumées noires d’incendies. Ailleurs des goélands survolaient.
Je viens d’installer mon premier bivouac entre des pins. Au fil de la journée, des groupes de personnes m’ont dépassé sans qu’aucune parole ne fût échangée. Des enfants aux joues pâles faisaient partie de certains de ces petits pelotons. Il y avait aussi des personnes solitaires, j’en ai doublé quelques unes. Je ne suis pas le seul à fuir la ville. Demain je continuerai à marcher vers les montagnes. Et après-demain et les jours qui suivront, entre ciels noirs et ciels bleus en essayant de ne pas me retrouver en mauvaise posture. Il faudra que je trouve de l’eau.
J’ignore s’il y aura quelque part une arrivée.
Le départ est sans retour
Qui s’en va c’est pour de bon
Omar Khayyâm (1048-1131)
Alain B., Jour 111.1 …………2020
FIN
(*) Voir les épisodes : le Jour 66.6 et le Jour 77.7
Pou rlire les autres textes de l'auteur :
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone, Jour 55.5, soir
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone, Jour 66.6, après-midi
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone, Jour 77.7, soir
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone, Jour 88.8, matin
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone, Jour 99.9, nuit
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone,Jour 100.0, après-midi
Entamez un dialogue : écrivez-lui à notre adresse decameron2020@albiana.fr, nous lui transmettrons votre message !

















