- Decameron Libero
- 9 likes
- 1428 views
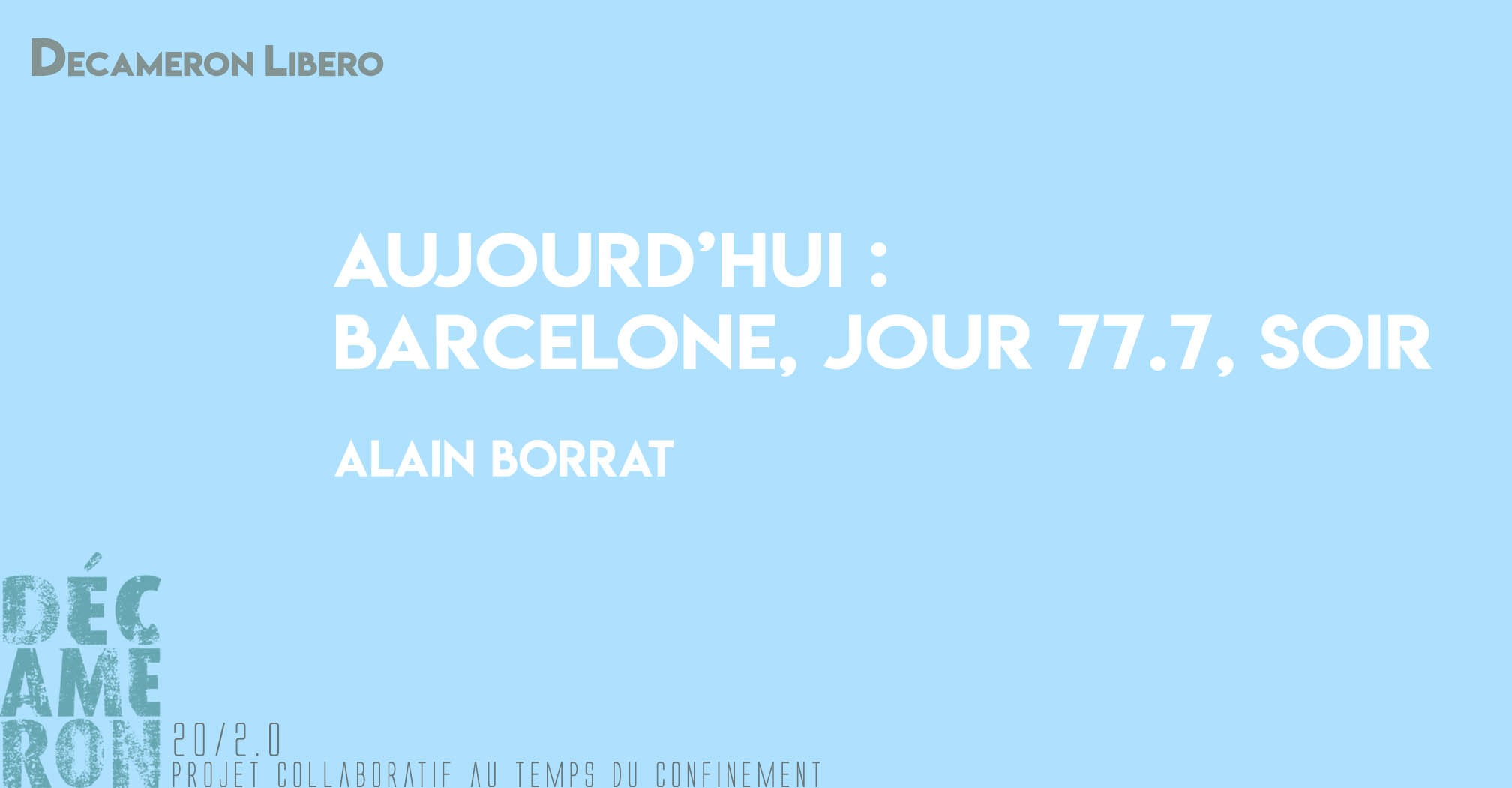
Dans Barcelone du confinement, les choses continuent de se gâter. Le héros s’adapte comme il peut, dans un monde où l’homme a perdu la partie… par Alain Borrat
Pour lire les épisodes précédents :
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone, Jour 55.5, soir
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone, Jour 66.6, après-midi
La vie au temps du confinement.
Aujourd’hui : Barcelone, Jour 77.7, soir
Résumé des épisodes précédents :
Depuis le Jour 60, toutes les décisions sont prises par le Conseil Sanitaire de Guerre. Celui-ci a pris en charge l’alimentation de la population et diffuse un bulletin quotidien d’information à la radio. Il vient d’annoncer un décret interdisant aux habitants leur présence sur les balcons. Quant à notre héros, s’il n’entend pas la musique, les voix de la radio et de sa voisine lui parviennent nettement. Ses oreilles semblent s’être stabilisées à un virgule un centimètre…
Le CSG avait bien dû y penser que cette histoire de Décret Balcons ça n’allait pas se passer tout seul. Le premier soir de son application annoncée, à vingt heures précises, nous étions tous dehors sur nos balcons. Constat pas si étonnant, nous étions munis de grosses gamelles et de louches. Ce n’était plus une casserolada mais bien une gamelada, et on peut dire que tout de suite ça s’est mis à cogner fort.
Je vis dans un quartier rebelle dans une ville rebelle d’une région rebelle. Historiquement, politiquement, socialement, familialement, viscéralement. Alors on a tapé sur nos gamelles, hardi petit. Quelqu’un a lancé No No No. Nous avons repris ces trois Non en les rythmant de nos coups de louches. Ça donnait une sacrée ampleur, ça vibrait à en faire swinguer les branches des quelques arbres que l’on a sur la Place. Il était certain que les autorités ne nous entendraient pas, ou n’en tiendraient aucunement compte. C’était davantage une façon collective de sortir de nos enfermements, de nous sentir un peu ensemble, c’est tout ce qui nous restait.
On a entendu une voix de femme qui a hurlé Libertad et puis juste après un bruit sourd, et qui devenait très profond et très vilain à mesure qu’il s’approchait. Ça venait de la rue adjacente, l’image elle n’a pas tardé à apparaître. Nous avons vu un gros char sur roues, de couleur bleu nuit, avancer lentement sur la Place. Ses deux extrémités présentaient la forme d’une tête d’une sorte d’animal comme un croisement improbable entre un ornithorynque et une pangoline, avec une trompe en érection. Ça de chaque côté. De mon balcon, j’ai compté deux fois douze roues, des grosses plus grosses que celles des gros camions. J’ai pensé à la pochette d’un vieux disque d’Emerson Lake and Palmer, Tarkus. Dans le ciel, tout près au-dessus, est passé un hélicoptère.
Au milieu du monstre bicéphale à présent installé au centre de la Place, un gyrophare s’est allumé, qui d’un large rayon jaune a balayé nos balcons. Nous avions arrêté de taper, fascinés autant qu’effrayés que l’on était. Nous avons tous constatés qu’un mécanisme avait été déclenché, faisant tourner l’engin à une vitesse très rapidement devenue folle. Les deux trompes, aux bouts, crachaient un liquide sous pression avec une force extrêmement puissante. Cela atteignait de façon giratoire absolument tous les balcons.
J’ai juste eu le temps de me précipiter chez moi et de fermer mes volets après avoir reçu un violent impact à l’épaule gauche. L’hélicoptère semblait s’être arrêté au milieu de la Place.
La même scène s’est reproduite le lendemain à la même heure. Les gamelles, les louches, No No No scandé, mais j’ai remarqué que nous étions un peu moins nombreux à nos balcons. La bête bleu marine a pris possession de la Place beaucoup plus vite que la veille, avec son rayon jaune et son jet de liquide tourbillonnant, fermant fenêtres et volets dans des paniques. Vidant les balcons. Je ressens toujours une légère douleur à l’épaule.
C’est ainsi la situation depuis le soir du Jour 69. À leur tour les jolis balcons de notre jolie place sont devenus zones mortes, espaces interdits de soirs comme de jours.
Le monstre est resté là, installé à demeure pour une durée indéterminée. Veillant au grain, me dis-je lorsqu’à travers ma fenêtre, qui dorénavant me sépare du balcon, mon regard inévitablement s’y pose et se sent visé par l’une de ses deux trompe-canon. Cela m’arrive une bonne douzaine de fois par jour, de vouloir voir l’extérieur. Un gros bourdon s’invite fréquemment et avec insistance : c’est l’hélicoptère. Je n’en mène pas large.
L’autre nuit, j’ai été réveillé par un aboiement. On se demande : Suis-je éveillé ou dors-je ? Ma chambre est située au-dessus d’une rue jadis fertile en bars et restaurants, généreuse en coups de gueule nocturnes, en chants collectifs, en discussions avinées. Mon sommeil a bien été forcé de s’adapter aux réveils abrupts en pleine nuit.
Un aboiement, ce n’était jamais arrivé, jamais. Je dis aboiement, c’était un peu autrement que cela. À présent réveillé et l’ouïe aux aguets malgré mes petites oreilles, m’est venue l’expression hurler à la mort. On l’utilise pour les chiens, je crois. Milou pleurant Tintin dans Les cigares du pharaon. Mon réveil marquait trois heures vingt-cinq. J’avais bien conscience que les bruits de chiens, aussi, entraient dans mes tympans.
Un autre aboiement a suivi, se mêlant au premier sur un ton plus aigu. Puis un troisième et un autre et un autre encore. Cela résonnait comme une symphonie incontrôlée dans laquelle chaque instrumentiste aurait décidé de n’en faire qu’à sa tête sans se soucier des autres ni de la partition. Cela résonnait comme un opéra sinistre de hurlements à la mort.
J’ai tiré un coin du rideau de ma chambre, j’ai risqué un œil. En bas dans la rue était stationné un camion aux portes fermées de la même couleur bleu nuit que le char anti-balcons. J’entendais ronronner son moteur par-dessous les aboiements. Trois hommes en combinaison noire, épaisse, portant masques grillagés et gants volumineux sont sortis d’un immeuble d’en face, du côté des numéros impairs. Chacun d’eux tirait un chien à l’aide d’une laisse et c’était tout un effort car je pouvais me rendre compte que les chiens faisaient de la résistance, même le plus petit. La porte arrière du camion s’est ouverte. Les hommes en combinaison noire y ont fait entrer les trois chiens avec les laisses. On voyait bien que c’est un travail difficile qui demande beaucoup de force et de volonté. La porte arrière du camion s’est refermée. Les hommes sont montés dans la partie avant du camion. Une femme a crié dans la nuit. Un homme a déversé des insultes. C’était déchirant, ce cri et ces insultes. Le camion est parti, il a tourné dans la rue à droite. Les aboiements se sont faits un peu plus lointains mais je les entendais encore, un peu étouffés. Je n’ai pas pu me rendormir.
Ça m’a beaucoup donné à réfléchir, cette Nuit des Chiens. Après avoir noté Jour 72 sur mon cahier noir et avalé une tasse de cet infâme café en poudre qu’ils nous livrent, je crois avoir compris le but de l’opération. Ce n’est qu’une supposition, bien sûr, mais quelque chose me dit que je ne dois pas être bien loin de la vérité.
Depuis le Jour 60 et la mise en place du CSG, depuis que le peu de commerces qui restaient ont abaissé leurs rideaux de fer, depuis que nos repas sont déposés sur le seuil de nos immeubles, toute sortie est impossible. Pas formellement interdite, mais rendue impossible.
Aux quatre coins de la Place, et je ne parle que de ce lieu, le seul que je vois, des check-points ayant la forme d’étroites chicanes constituées de sacs de sable sont installés, gardés par des hommes en armes.
Il faut avoir une urgence médicale dûment certifiée pour sortir de chez soi (c’est une énigme, cette réglementation du CSG : comment peut-on obtenir un laisser-passer pour une urgence médicale dûment certifiée ?). Ou avoir un chien à promener ! C’était devenu l’unique moyen. Ils n’allaient pas bien loin, les promeneurs de chiens, un petit tour pour les besoins de l’animal contre un arbre ou au milieu de la rue, et retour maison.
Plus les jours passaient et plus cela donnait l’impression que c’étaient les chiens qui promenaient les humains.
Plus de chiens, plus de promeneurs ! Il suffisait d’y penser. Le confinement le plus rigoureux est l’unique solution pour éradiquer le virus. C’est en ces termes que se conclut le bulletin quotidien d’information.
Celui de dimanche dernier a commencé d’une manière assez étrange et je n’ai pas su si je devais en rire ou en pleurer. La porte-parole a commencé son communiqué en annonçant que notre pays avait dépassé le cap des cent mille décès. Puis elle a ajouté que nous étions dans ce domaine à la deuxième place des pays du monde. J’ignore si c’est à cause de ce réflexe de méfiance que j’ai toujours lorsque j’allume la radio à treize heures, mais il m’a semblé percevoir dans ces deux phrases comme un je-ne-sais-quoi de fierté nationale et d’encouragement. Comme si on était arrivés à la finale de la Coupe du monde et que l’objectif était maintenant de conquérir la médaille d’or.
Elle a poursuivi avec l’habituel blabla de l’unité nationale, des efforts de chacun, de tous les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Pour ce faire, a-t-elle continué, et dans un souci d’optimiser au mieux les ressources essentielles à notre nation, les livraisons des denrées alimentaires seront effectuées, à compter de demain lundi, entre six heures et sept heures du matin selon les modalités déjà mises en place par le Conseil Sanitaire de Guerre et qui déjà ont apporté de notables améliorations dans le bien-être de la population, je vous remercie de votre attention.
La modification n’a pas seulement porté sur les horaires, mais également sur le contenu des rations. De la confiture d’oranges a remplacé celle de fraises, il n’y a plus qu’un seul paquet de clopes, les quatre abricots secs sont devenus huit amandes décortiquées. Les nouilles et le pinard semblent immuables. À propos du pinard, je commence à sentir certains dérèglements dans mon estomac. Plus précisément, il me semble que chaque gorgée que j’absorbe contribue à creuser un trou à l’intérieur de mon ventre. Je souhaiterais échanger le pinard contre du lait, mais je n’ai pas la moindre idée de la façon dont il faudrait adresser cette demande ni à qui. Demain j’irai mettre un mot sous la porte de mes voisins. Je doute cependant qu’ils puissent m’apporter une aide ou un conseil dans ce sens.
Dans l’approvisionnement, on trouve aussi depuis lundi une petite plaquette contenant quatre gélules rose et bleu. Il n’est pas indiqué dans quel cas les prendre. Un autocollant signale : deux le midi deux le soir. Jusqu’à présent je n’y ai pas touché, je les dépose dans un bol. J’ai déjà trois plaquettes, soit douze gélules.
Comme nous ne pouvons plus sortir, nous avons pris l’habitude de jeter nos poubelles par la fenêtre. Il faut effectuer cela bien rapidement afin de ne pas paraître en train de lambiner sur le balcon.
Elles sont bien maigres, nos ordures. Elles sont constituées principalement par les parties inutilisables ou déjà consommées : les emballages, les mégots de clopes, un reste de nouilles qui a accroché au fond de la casserole. On met tout cela dans le petit sac bleu qui sert de contenant à la ration par domicile, on ouvre prestement la fenêtre et hop ! ni vu ni connu. Personnellement, j’effectue cette opération en moyenne tous les trois jours. J’y ajoute parfois un stylo vide de son encre, quelques vieilles feuilles de papier où nul espace ne reste, une bouteille vide conservée sentimentalement depuis des années dans un placard.
La Place s’est donc rapidement jonchée de ces petits sacs bleus que personne ne vient ramasser. Il semblerait que les employés des services municipaux préposés aux ordures ménagères sont eux aussi en confinement total.
Ce sont les chiens qui sont bien contents de cet état des lieux. Dès le lendemain de la Nuit des Chiens, les canidés ont pris possession de la Place, à croire que le camion fourrière les y avait tous déposés. Ils ne portent plus de laisse, des groupes se sont formés. Des hordes, on peut le dire. Je passe beaucoup de quarts d’heures à les observer depuis ma fenêtre. C’est un peu un spectacle obligatoire car leurs aboiements et leurs jappements m’empêchent de me concentrer sur la lecture, cela aussi est en train de devenir impossible.
Il y a des luttes fréquentes entre les chiens. Cela se remarque surtout dès qu’un sac bleu tombe d’une fenêtre, ils sont une vingtaine à s’y précipiter toutes gueules ouvertes. Les plus gros font la loi, excluant d’un coup de croc sec les gringalets. Ils se retrouvent à cinq ou six autour du paquet de détritus, se défiant à coups d’aboiements violents, se mordant l’échine, se griffant le cou, certains visent les yeux. Un gros chien noir dont j’ignore la race semble être le caïd. Il attend que les autres soient blessés, fatigués, il s’approche, pousse trois ou quatre grognements lourds de menaces au milieu des pelages ensanglantés et se met à dépecer le sac en plastique.
Je ne comprends pas bien pourquoi de tels combats, connaissant le maigre contenu de nos ordures. Peut-être ont-ils encore bien vive la mémoire de l’espérance de l’os du gigot du dimanche.
Parfois l’un d’eux lève la patte et se soulage sur une roue du char. Cela me fait sourire tristement, on a les petits bonheurs que l’on peut.
Le sol de la Place, fait de dalles carrées, beiges, est maintenant dans un état de saleté ahurissant. Car à nos sacs de déchets se sont ajoutés les excréments canins, des étrons de toutes tailles, de toutes teintes et de toutes consistances. Avec la chaleur de fin de printemps qui enveloppe la ville, il s’en dégage une odeur exécrable, encore supportable mais qui inévitablement deviendra pestilentielle à court terme. De grosses mouches noires entrent par ma fenêtre, il est difficile de s’en débarrasser.
C’était quoi, cette jolie place urbaine, il y a très très longtemps ? Un bois, vraisemblablement. C’était l’ère des sangliers, des merles, des scolopendres. L’humain a rasé tout cela, s’est approprié l’espace et l’a transformé. C’était l’ère des humains, qui a duré pendant des milliers de générations, jusqu’à ces dernières semaines. C’est à présent l’ère des chiens. Je doute qu’elle durera bien plus longtemps que celle des pigeons.
En effet, on voit des oiseaux blancs survoler la Place, de plus en plus près, de plus en plus nombreux.
Il y a très longtemps, un ami qui s’y connaît en oiseaux m’avait expliqué la différence entre une mouette et un goéland. Vivant près du littoral méditerranéen, j’ai eu à de multiples reprises l’occasion de mettre en observation cette connaissance. En résumé, ceux qui essaient de barboter le pique-nique, ce sont les goélands, plus gros, le bec jaune recourbé vers le bas, l’œil mauvais, sournois, pouvant à l’occasion se montrer agressifs. J’aime pas les goélands, j’ai appris à m’en méfier.
Les goélands attendent leur heure, leur ère. Les chiens passent leurs jours et leurs nuits à aboyer et à se battre. Tout à l’heure, une ambulance à la sirène hurlante s’est arrêtée dans la rue adjacente. Deux Agents de la Sécurité Sanitaire, ceux avec la combinaison blanche, sont montés dans un immeuble avec un brancard.
Allons essayer de dormir un peu. Demain sera un autre jour identique.
Alain B., Jour 77.7 ………… 2020
Entamez un dialogue : écrivez-lui à notre adresse decameron2020@albiana.fr, nous lui transmettrons votre message !

















