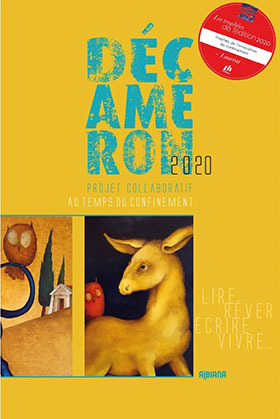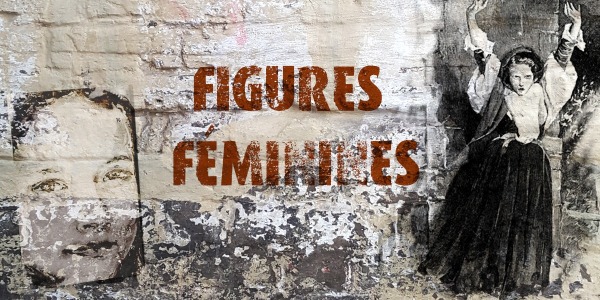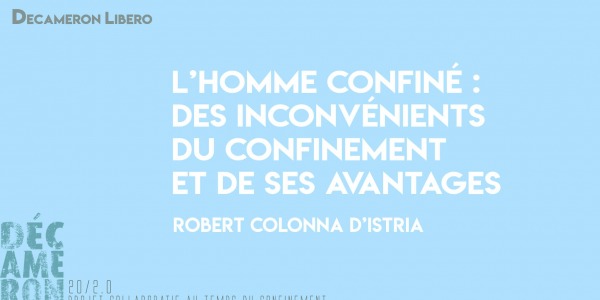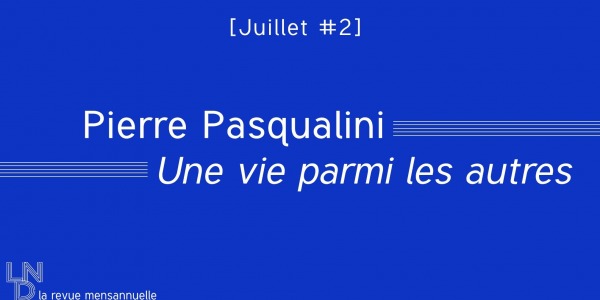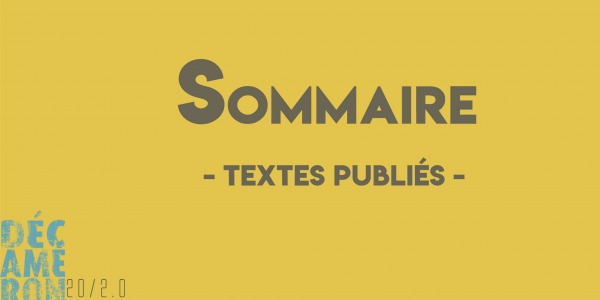- Decameron Libero
- 3 likes
- 1596 views
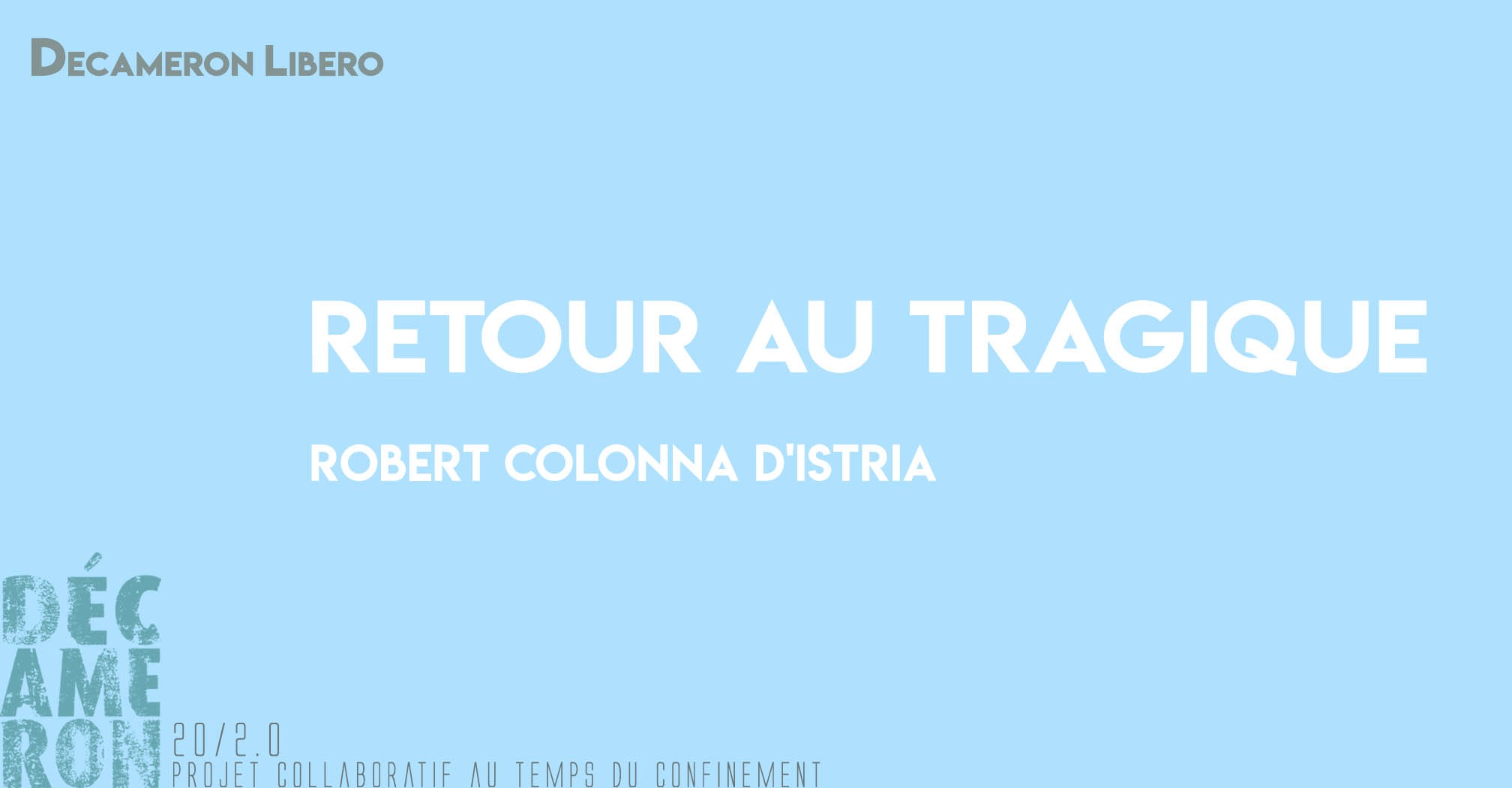
L’homme confiné scrute le monde tel qu’il est/était… et l’impact du séisme du coronavirus.
Retour au tragique
À sa naissance, la population mondiale comptait 2,7 milliards d’habitants. Aujourd’hui, elle avait pour ainsi dire triplé : la terre était peuplée de 7,6 milliards de personnes. Chiffre qui s’accroissait chaque année de 83 millions, différence entre les naissances annuelles, 140 millions, et les décès, 57 millions. En une existence, son poids relatif sur la terre avait été divisé par trois…
Les principales causes de mortalité étaient les suivantes : pollution de l’air (8,8 millions), tabagisme (7,2 millions), alcoolisme (3 millions), malnutrition (3 millions), obésité (3 millions), accidents et maladies du travail (2 millions), accidents domestiques (2 millions), sida (1,5 million), accidents de la route (1,25 million), tuberculose (1,25 million). Sans parler des suicides (800 000), de la grippe saisonnière (650 000), du paludisme (405 000), des intoxications alimentaires (420 000), des homicides (475 000), des morts liées à la drogue (183 000) ou des attaques de requins (5)…
Avec environ trois millions de personnes infectées, 873 000 guérisons, et 228 000 décès (au 29 avril 2020), le covid ne semblait pas un concurrent très sérieux dans cette course morbide. À ce jour, il avait tout de même tué 61 000 personnes aux États-Unis (il avait tué davantage d’Américains, disait-on, que la guerre du Vietnam), 27 000 en Italie, 26 000 au Royaume-Uni, 24 200 en Espagne, 24 000 en France, 7 200 en Belgique, 6 500 en Allemagne, etc.
Si on rapportait l’épidémie actuelle à la grande peste du XIVe siècle – qui dans certaines régions avait tué 60% de la population, un massacre –, ou à la grippe espagnole, en 1918-1919 – entre 20 et 50 millions de décès –, elle n’aurait finalement, sur le plan démographique, été que peu de chose.
Il fallait pourtant la combattre.
À cette occasion, les habitants de la planète avaient découvert une nouvelle unité de mesure, qui permettait d’apprécier le taux de contagion d’une épidémie, sa vitesse de propagation. Au niveau R0, la maladie portée par quelqu’un ne se transmet à personne. Au niveau R1, un malade contamine une autre personne. À R2, il transmet la maladie à deux autres personnes. Etc. Pour faire reculer une épidémie, les responsables de la santé publique cherchent les moyens de faire tendre cet « R » vers zéro. Soit en invitant tous les gens à rester chez eux (c’est le principe du confinement général), soit en repérant les personnes contagieuses, malades ou pas, et en les isolant du reste de la population (c’est le vieux principe de la quarantaine). Il y avait eu des débats entre les tenants des deux thèses – sans parler de ceux qui, un temps, avaient estimé qu’il n’y avait rien à faire, qu’il y aurait des morts, et qu’il ne fallait pas s’empêcher de vivre à cause de cela ; les Anglais, au départ de l’épidémie, avaient raisonné de la sorte : ils avaient rapidement dû faire machine arrière, mais, comme ils avaient laissé la maladie prendre ses aises, ils se retrouvaient avec un pays confiné et avec le plus grand nombre de morts en Europe.
Pour la France, l’institut Pasteur avait estimé que les mesures de confinement avaient évité 60 000 morts.
Un des mérites de ces procédés archaïques – confinement général ou quarantaine – était de donner aux chercheurs du temps pour trouver et mettre au point des stratégies sûres contre la maladie. À défaut de pouvoir tester les populations, on testait des médicaments à tour de bras, on vérifiait leur efficacité, on appréciait leur innocuité, on mesurait leurs effets indésirables, on cherchait de nouvelles molécules, on travaillait d’autant plus fébrilement sur les remèdes à la maladie que les perspectives d’en obtenir jamais un vaccin s’éloignaient avec le constat – désolant – que l’immunité conférée aux malades ne semblait pas définitive. Le monde était à l’arrêt, mais les laboratoires étaient en pleine effervescence.
En pratique, l’épidémie de covid-19 n’avait pas été très meurtrière, mais elle avait rapidement pris une importance symbolique considérable.
D’abord parce que, dans les pays développés, on avait oublié l’existence des risques sanitaires majeurs – ce n’était plus pour nous, c’était d’un autre âge – du moyen-âge – on n’avait jamais voulu y croire – les précédentes épidémies, grippe aviaire, peste porcine, SRAS, Mers, etc., s’étaient miraculeusement arrêtées d’elles-mêmes, à nos portes, plus inquiétantes, en définitive, que vraiment mortelles. On n’avait jamais eu l’expérience d’une maladie touchant toute la population, massivement, et toute la planète à la fois. On n’y croyait pas : le nouveau coronavirus nous avait rappelés à l’ordre.
Ensuite parce qu’on avait eu peur. Si 85% ou 90% des malades du covid s’en sortaient avec des formes bénignes, s’il suffisait pour les guérir d’un peu de temps et de poudre de perlimpinpin, une petite proportion de patients présentait des formes sévères, qui nécessitaient une hospitalisation, parfois une admission en services de réanimation. Or les services hospitaliers, partout dans le monde, étaient trop petits – du moins pouvaient-on craindre qu’ils fussent trop petits – pour accueillir tous ces malades à la fois. Partout, on avait eu peur d’être débordé. Et si nous n’étions pas en mesure de soigner nos populations ? Et si nous étions dépassés par les événements ? Et s’il nous fallait constater un grand nombre de morts ? On s’était paniqué.
Enfin, parce que cette épidémie était en un tour de roue devenue une pandémie, avait concerné la terre entière. Non seulement cette crise avait été inattendue – donc pas prévue, pas prévenue et pas préparée –, mais elle avait d’emblée, en quelques semaines, été mondiale, ne laissant pour ainsi dire aucune région à l’abri. Elle avait pris des proportions affolantes. Il avait été impossible d’y échapper.
Au total, l’importance donnée à la crise, et la réponse qui y avait été apportée – le confinement de milliards d’individus sur la terre – avait été due à un mélange détonnant : un événement qui avait surpris tout le monde ; une maladie qui semblait revenir du fin fond d’un passé oublié, de l’âge des grandes épidémies, terrifiante ; une crise mondiale, dans laquelle, assez vite, chacun avait eu peur de ne pas faire assez bien, et avait calqué son comportement sur celui des voisins. Tout cela amplifié par un emballement médiatique : martelées jour et nuit pendant des semaines, la terre n’avait été abreuvée que de nouvelles angoissantes, obsédantes. Même lui, dans son ermitage, ne parvenait pas à y échapper.
Peu importait, dans le fond, se disait-il, les raisons des décisions prises, peu importait de savoir si on aurait pu faire autrement, si le confinement avait été la meilleure solution possible, une solution efficace – aux chiffres, on faisait tout dire et le contraire de tout –, peu importait ces débats : la crise avait pris ces formes-là. C’était ainsi qu’elle s’était imposée aux hommes, qu’elle les avait interpelés, dans leur corps, dans leur vie quotidienne, dans leur conscience.
La crise du coronavirus avait surpris les habitants de la planète, en tout cas les Européens et les Américains, qui ne savaient plus rien – s’ils en avaient jamais su quoi que ce soit – de l’existence et de la dangerosité des virus d’origine animale. Alors que, depuis quelques années, annonçant le nouveau coronavirus, était apparue une collection spectaculaire de maladies nouvelles : Ebola, chikungunya, Sras, Mers, Zika, Nipah, grippes diverses (de Hong-Kong, H1N1, H5N1…), fièvre de Lassa, fièvre de Crimée-Congo, virus du Nil occidental, etc. Au nom peu appétissant, ces maladies infectieuses avaient toutes été transmises à l’homme par la faune sauvage ; quatre ou cinq maladies nouvelles – par bonheur pas toutes dramatiques – émergeaient, paraît-il, chaque année dans le monde : les laboratoires de recherche, toujours eux, allaient avoir du pain – et du virus – sur la planche.
Ces zoonoses, ainsi qu’on désignait les maladies transmises des animaux aux hommes, était vieilles comme l’humanité. Mais, bien protégés par une bonne médecine, par de bons vaccins, les habitants des pays développés en avaient perdu le souvenir. Sans réaliser que leur cadre et leur mode de vie étaient devenus très favorables au développement ultra rapide de ces maladies. La terre n’avait jamais été aussi peuplée – ce qui augmentait les risques de transmission des animaux à l’homme, et les risques de contagion entre humains : pour les virus le surpeuplement était une aubaine. La terre n’avait jamais été autant exploitée, ses moindres recoins explorés, labourés, mis en coupe réglée, ce qui avait rapproché les hommes des réservoirs de virus qui, depuis des millénaires, étaient parfaitement satisfaits de n’être portés que par des chauves-souris, des oiseaux rares, des crocodiles ou des pangolins. Enfin, jamais les déplacements autour de la terre, expression de l’activité fébrile des hommes, n’avaient été si nombreux, dans tous les sens : quand un virus apparaissait ici, il était immédiatement transporté là, emporté un peu plus loin, pour se multiplier ailleurs. Quand le virus de la peste voyageait autrefois sans se presser, à dos de chameau, au rythme des bateaux à voile, celui du covid faisait le tour du monde en quelques heures : il adorait les vols supersoniques. C’était prodigieux. Et inquiétant.
Allait-il falloir s’habituer à ces phénomènes nouveaux, à leur survenue régulière ? Changer radicalement de mode de vie ? Réduire drastiquement la population de la planète ? Limiter considérablement les voyages autour du monde, pour les ramener, par exemple, à leur niveau d’il y a trente ou quarante ans, quand ils n’étaient que le tiers ou le quart de ce qu’ils étaient devenus ? À chaque jour suffisait sa peine : pour l’heure, il fallait lutter contre ce coronavirus-là.
La terre entière avait été inquiète – apeurée – de prendre conscience du danger redoutable qu’elle côtoyait sans le savoir.
En confinement – pourvu que ses conditions matérielles, intellectuelles, affectives fussent agréables ; c’était son cas –, la vie était calme, silencieuse, sereine. À la longue un peu morne, d’une certaine façon, mais pas pénible. Ce qui rendait ces étranges journées parfois pesantes, c’était le climat général de la ville : la mort rodait. Elle était palpable partout, dans les rues, vides, privées de vie. Elle se promenait – ce qui la rendait symboliquement encore plus terrible – non seulement avec les malades, toussant et crachotant, accablés de fièvre, épuisés – c’était l’image des lépreux ou des pestiférés d’autrefois, avec leur clochette, qu’ils agitaient pour prévenir de leur arrivée, et inviter chacun à se cacher ; cette variété de malade était à la vérité rarissime –, mais elle circulait également avec des personnes apparemment saines, sans le moindre symptôme de la maladie, pourtant chargées du fameux virus, hyper-contagieuses. Tout le monde était équipé d’un masque, et la mort, elle-aussi, se promenait dissimulée. Chacun, du coup, avait peur d’être contaminé par l’autre, par n’importe quel autre. Tant que le virus ne serait pas dompté, tant qu’on n’y aurait pas trouvé parade, cela promettait des lendemains bien tristes ! Bien sombres ! Chacun avait peur, ceux qui se savaient à risque – qui n’avaient aucune envie de se faire contaminer –, ceux qui avaient déjà été malades – et ne tenaient absolument pas à replonger –, tous les autres, en bonne santé, parce que le fameux virus avait fini par être synonyme de grand danger.
L’épidémie, la mort muette au cœur de la cité, la contagion qui menaçait, avaient fait remonter des tréfonds de la conscience refoulée des notions complètement oubliées. D’abord que les épidémies avaient parfois été des tueuses de masse, les plus redoutables des criminelles contre l’humanité. Ensuite qu’elles avaient souvent été, dans l’histoire des hommes, des accélérateurs de la décadence. Informations redoutables. Inquiétantes.
À Athènes, la peste du Ve siècle avant Jésus-Christ – on en avait conservé les récits de Thucydide, qui circulaient sur les réseaux sociaux : chacun pouvait faire des comparaisons, c’était troublant –, probablement apportée à l’espèce humaine par des poux de corps, avait précipité le déclin de la cité. La peste justinienne – véhiculée par les puces, puis par les rats –, avait été ainsi nommé pour avoir commencé ses ravages sous le règne de l’empereur Justinien, en 540. Elle s’était propagée d’Asie en Europe, le long des routes, terrestres et maritimes, causant entre 25 et 100 millions (!) de morts autour du bassin méditerranéen, et jouant un rôle non négligeable dans l’écroulement de l’Empire romain. La célèbre Peste noire, au milieu du XIVe siècle – toujours transportée par des puces et par des rats, et toujours arrivée en Europe depuis l’Asie, par le biais de bateaux de commerce, génois et vénitiens, qui naviguaient entre la mer Noire et la Méditerranée occidentale –, cette peste avait par endroits tué plus de la moitié de la population européenne ; dans un continent qui comptait de 70 à 100 millions d’habitants, elle avait été responsable de la mort de 25 à 50 millions de personnes. La grippe espagnole, dont le virus – sans doute venu d’Asie – était lui aussi porté par des animaux, des porcs probablement ou des volailles, avant de passer à l’homme, avait tué de 20 à 50 millions de gens. Les intentions homicides du nouveau coronavirus semblaient moins ambitieuses, mais qui pouvait assurer qu’il ne viendrait pas à muter et à faire lui aussi, sur le plan sanitaire, des ravages mortels, par millions ou dizaines de millions ?
La mort rodait. Et prenait des dimensions cosmiques. Sous les toits, en s’informant sur la maladie, il avait appris que beaucoup en étaient venus à craindre – rien de moins – la menace de l’extinction de l’espèce humaine. À force d’avoir abusé de la nature, de l’avoir faite souffrir, elle se vengeait… Le pire était à redouter. Il eut l’intuition que sans aller jusqu’à accorder du crédit à cette issue millénariste, on touchait du doigt que beaucoup de nos activités et de nos pratiques étaient essentiellement toxiques, et qu’il faudrait y renoncer. Donc remettre en question un certain nombre de dogmes, de croyances qui fondaient le monde contemporain…
Le virus, estimait-il, avait agi comme un révélateur. En quelques semaines, à cause de cette microscopique bestiole – mesurée en angström, c’est-à-dire en millionième de millimètre ; ce n’était pas bien grand… –, le sentiment de toute puissance conféré à l’homme par sa foi matérialiste semblait s’être effondré. Le virus avait mis à genoux un monde qui, hier encore, il y a quelques semaines, était sûr de lui, ne doutait de rien. Ses dirigeants, arrogants, que rien ne semblait pouvoir atteindre, se réunissaient régulièrement, en sommets des maîtres du monde, pour planifier l’essor de l’économie, les cours du pétrole ou le prix des monnaies. Monde qui se regardait avec autosatisfaction, avec suffisance même, pénétré de la certitude d’être parvenu au point le plus haut du sommet de l’épanouissement humain. Monde qui donnait des leçons à tout le monde. Avait-on jamais connu pareille opulence ?
De sa terrasse ensoleillée, il avait vu les bourses dévisser, la croissance se ratatiner, le chômage exploser : plus personne ne contrôlait plus rien.
La crise avait révélé la fragilité du système économique. Donc du système politique, social. La fragilité du monde contemporain mondialisé. Serait-il possible, après la crise, de jamais retrouver la vie d’avant ? Avec, pour récompense, la joie de consommer, toujours plus, des biens de plus en plus gros, de plus en plus chers, accumuler de la matière ? La crise avait révélé le vide de tout cela. La belle insouciance du monde occidental en avait pris un coup. Balayée en quelques semaines, déstabilisée par une maladie, une épidémie, c’est-à-dire un phénomène réputé moyenâgeux, tenu dans le monde développé pour un signe d’arriération.
Il avait fallu mettre des gens en quarantaine, les confiner, les équiper de masques.
L’épidémie n’était pas très mortelle, mais elle amenait à se confronter à quelque chose de pire que la mort pure et simple : l’impuissance du modèle auquel on avait adjuré les hommes de croire. Chacun se retrouvait pareil à l’enfant qui réalisait que le monde décrit par ses parents n’était pas aussi tendre et sain et bon que ce qu’ils lui avaient laissé entendre. Là, c’étaient tous les enfants de la modernité – du progrès, de la science, du monde industriel, ce que nous étions tous, et ce qu’il était, confiné face à un paysage sublime – qui réalisaient que la modernité – le progrès, la science, le monde industriel – n’étaient pas omnipotents. Qu’ils pouvaient trébucher. Avoir un accroc. C’était dans le fond peut-être plus perturbant que la mort elle-même – dont il était difficile, même si elle était refoulée, cachée, d’ignorer complètement l’existence.
Combien de temps faudrait-il pour retrouver le niveau de production, de consommation, de revenus d’avant la crise ? Autrefois, on aurait pu mettre des experts sur l’affaire, pour répondre à cette interrogation. Aujourd’hui, tout le monde était perdu. Pataugeait. Y compris les experts.
La prétention à dominer la nature avait été, depuis Descartes, un des fondements de l’idéologie de la modernité. Avec la crise du coronavirus directement liée à la surexploitation et au mépris de la nature, elle était en train de montrer ses limites. Elle était devenue Icare tué par son ambition de se rapprocher du soleil, Prométhée puni pour avoir voulu dérober le feu sacré, et permettre aux hommes d’égaler les dieux. Sous les traits du capitalisme mondialisé, la modernité avait pris des proportions mythologiques. On avait voulu produire toujours plus, toujours accumuler davantage de richesses, voyager de plus en plus loin, avec l’ambition – la prétention – de dépasser les lois de la nature. De s’affranchir de ces lois.
Autre paradigme de la modernité mis à mal par la crise : le rationalisme. Depuis des siècles – encore depuis Descartes – le monde occidental vivait avec l’idée que tout pouvait s’expliquer, que la raison – parfois écrite avec une lettre majuscule, comme une divinité – contrôlait tout, permettait tout, dominait tout. D’où le « désenchantement du monde » constaté – et regretté – par Max Weber : les choses avaient perdu leur mystère, cette approche était ennuyeuse… Avec le temps, la foi dans la raison s’était prolongée par la foi dans la science, puis dans une confiance infinie dans la technique, qui, dans les années récentes, s’était donné comme ligne de mire le prolongement indéfini de la vie, voire l’immortalité, en tout cas la toute-puissance, d’où tout ce qui relevait du transhumanisme, de l’augmentation des capacités naturelles de l’homme : la raison avait donné naissance à une nouvelle mystique. Pour régénérer les corps vieillissants, ne serait-on pas capable de procurer – en vrac – nouveaux tendons, meilleures pupilles, mémoire infaillible et illimitée, os résistants, cœur inoxydable…? L’effet de tout cela – ou la cause de tout cela – avait été d’éloigner, écarter, cacher, refouler une donnée de base de l’existence : la finitude de la vie. Qui était pourtant une donnée de base de la vie animale.
Avec l’épidémie de Covid, cet impensé de l’époque contemporaine, faisait un retour en force : chacun redécouvrait qu’il était mortel, fragile, exposé aux maladies. Chacun redécouvrait qu’il était vivant, donc qu’il allait mourir. Donnée, qui était même une des plus essentielles de la vie. Un lieu commun qu’il fallait amadouer, dont il fallait se faire un ami, au lieu de prétendre le nier. Le coronavirus – ce n’était pas rien – avait montré que le rationalisme, lui aussi, était mortel.
Il avait montré la vanité du progrès, du moins du mythe du progrès, d’un progrès général, universel, incontestable, supérieur à tout, moteur des sociétés : ce mythe – grande idée du XIXe siècle, qui avait duré au siècle suivant, qui s’était épuisé, pendant les trente glorieuses, en nouveaux produits de consommation, gadgets, voitures automobiles, télévision ; on se souvient à quel point chaque minuscule avantage de détail dans l’ordre matériel avait été perçu comme une avancée de la civilisation, une joie, célébré ; ce mythe avait abouti à créer, pour toute l’humanité, un monde virtuel, où elle se retrouvait, échangeait, commerçait, apprenait, se distrayait –, ce mythe s’était écroulé en un instant, épuisé, terrassé par une pandémie.
Au grand air et au bon soleil de son confinement heureux, il constatait que nous ne vivions pas mieux en définitive que les générations précédentes, puisque nous étions exposés – impuissants – à des maladies dignes de la préhistoire. Il observait – c’était fascinant – que le coronavirus avait surtout invité à ce constat : admettre qu’on ne savait pas tout, et qu’il n’y avait pas de solution humaine, pratique, concrète, technique, scientifique, à tout.
Constat vertigineux, angoissant. Comment – avec quelles armes – allions-nous faire face à cette grande crise ?
La peur – la peur essentielle, celle de la mort – circulait. Pour beaucoup, elle était un stimulant utile pour faire monter des ventes. Tous les marchands d’angoisse, d’anxiété faisaient des affaires prospères. Aux États-Unis, les armuriers connaissaient des chiffres d’affaires mirobolants. Leur argument de vente était imparable : « Si vous avez de quoi survivre, mais pas d’armes, vous ne constituez qu’une cible encore plus alléchante pour le reste de la société. À la moindre catastrophe naturelle, il suffit de regarder le comportement des gens : ils en profitent pour commettre des pillages et la police est débordée… » Les gens s’armaient. Partout la presse, écrite, radiodiffusée, télévisée, partout blogs et réseaux sociaux inondaient le monde d’informations anxiogènes : elles captivaient auditeurs, lecteurs, téléspectateurs, qui ne parvenaient pas à s’en libérer. Tournaient en boucle, répétées à l’infini, des chiffres, des messages, des images, des analyses inquiétantes, vertigineuses. La peur faisait vendre. Elle était une drogue. Les gens s’y accoutumaient, en redemandaient. Nombreux étaient ceux – marchands de papier, vendeurs de médicaments, experts en tous genres, qui monnayaient leur pseudo-savoirs, jusqu’au président malgache, qui proposait des flacons d’un produit miracle de son invention –, nombreux étaient ceux qui vivaient de la trouille, et qui pour vivre mieux, s’efforçaient de l’entretenir. C’était l’heure de gloire des « survivalistes », qui attendaient la fin du monde : ils offraient à leurs clients inquiets des résidences « sécurisées » – des bunkers en réalité, protégés par de hautes palissades et des miradors –, approvisionnées en eau, en énergie, en nourriture, leur permettant de survivre à l’effondrement de la société qui suivrait la catastrophe… Les conspirationnistes de tous poils avaient avec la pandémie un aliment de choix. Sur l’internet, ils s’entretenaient mutuellement. Ils assuraient que la maladie avait été mise à profit – sinon encouragée, voire provoquée – par des gens – toujours désignés de façon anonyme, « ils », « eux » – qui avaient le projet d’exercer leur dictature sur la terre, en contrôlant la population via des applications numériques, en surveillant la moindre des allées et venues de chacun, en mélangeant des milliers et des milliers de « méta données » pour asservir la planète. Bill Gates, sa fortune et ses ambitions philanthropiques était une cible de choix. Beaucoup voyaient dans la peur qui s’étendait sur la terre une illustration de ce qu’une journaliste canadienne, Naomi Klein, avait appelé la Stratégie du choc, titre d’un de ses essais : bien choquée, sidérée, une population était prête à accepter n’importe quoi, n’importe quelle servitude, pourvu qu’elle lui fût présentée pour son bien. À la peur de la maladie, les conspirationnistes ajoutaient la crainte d’une dictature mondiale. C’était glaçant.
La pandémie du nouveau coronavirus avait donc fragilisé deux espèces de religions modernes – pour ainsi désigner des systèmes de pensée qui proposaient des absolus et des réponses à tous les aspects de l’existence, et qui, intellectuellement, reliaient les hommes –, la science et le progrès. En laissant de nouveau s’exprimer la peur, elle permettait l’émergence de religions ou de sectes, anciennes ou nouvelles, qui bénéficiaient, pour une renaissance, d’une culpabilisation généralisée. « Tu as péché de vouloir trop d’argent, péché d’être trop gourmand, trop ambitieux, tu as voulu dominer la nature, tu t’es cru tout puissant… ». Ces rappels à l’ordre étaient relayés par tous les médias. La peur additionnée au sentiment de la faute, c’était un mélange extrêmement favorable à la naissance – ou à la renaissance – des religions. Y compris à la religion de la Nature, espèce de panthéisme menaçant, rationaliste, mondialiste, intolérant, qui à l’aide de petites vidéos sur la toile tentait de s’infiltrer un peu partout, sectaire… En réalité, ce discours culpabilisant circulait depuis longtemps : le coronavirus lui avait apporté une légitimité, du poids.
Quand, tout seul, sous ses toits, il réfléchissait aux effets du confinement, ce climat messianique ne l’inspirait guère, mais il se souvenait cependant que peur et sentiment du péché avaient, pendant des siècles, invité les hommes au scrupule, à la mesure, à la prudence. Vertus appréciables, aussi bien pour l’équilibre psychique que pour l’agrément de la vie en société. Ou pour le respect dû à l’environnement naturel. Et que la crise actuelle avait en partie pour cause la disparition de ces comportements posés.
Aux altitudes où il était confiné, il estimait qu’à l’image de la peste chez Sophocle, l’épidémie de coronavirus ramenait à la condition tragique de l’existence – c’est-à-dire à la confrontation avec un mal terrible, et à la prise de conscience d’une réalité indépassable, notre mort, la mort. Et si cette réalité était une des données les plus fertiles de la vie ? Le philosophe russe Léon Chestov assurait que « Tout ce qui a été créé de meilleur, de plus fort, de plus important et de plus profond dans tous les domaines de la création : science, art, philosophie et religion, prend sa source dans la méditation sur la mort et dans la frayeur qu’elle inspire. » Aurait-il pu dire mieux ?
La réflexion sur la mort – qui passait par la conscience de la mort, par son expérience – était féconde ; elle était même à la base de pans entiers de la philosophie et de la sagesse humaine. Les religions animistes étaient tout entières organisées autour de la mort – du souffle des défunts, qui migraient d’un être à l’autre, pour entretenir la vie – ; les religions du livre plaçaient la conscience de la mort au centre de leur pensée : « Tu es poussière et tu redeviendras poussière », était-il écrit dans la Genèse. C’était admis depuis des lustres. David Bowie avait repris l’idée pour titre d’une de ses chansons, Ashes to ashes. La religion catholique invitait à s’en souvenir pour remettre à leur place nos rêves mondains – richesses, succès, jeunesse, mode, carrière – qui ne visaient rien de durable, pour condamner l’égoïsme matérialiste, pour inviter à la générosité, à la solidarité – sentiments propres, en réalité, à tout idéal communautaire. Sans doute l’occasion de réfléchir sur la mort, parce qu’on y était immédiatement confronté, était-elle une chance.
« Il ne suffit pas de guérir la peste, avait estimé le précieux Miguel de Unamuno, il faut savoir la déplorer. Oui, il faut savoir pleurer, et peut-être est-ce là la sagesse suprême. Pourquoi ? Parce que cela ne sert à rien… et que se manifeste ainsi la volonté de ne jamais mourir, l’irrésignation à la mort, qui bâtit la demeure de la vie – sans cesse abattue par le doute froid de la raison. » En face de la mer, il aurait aimé être capable d’exprimer une pensée aussi profonde. Il l’avait recueillie sur ses tablettes, en se promettant de la relancer dans le monde.
Pour lire d'autres textes de l'auteur :
Entamez un dialogue : écrivez-lui à notre adresse decameron2020@albiana.fr, nous lui transmettrons votre message !