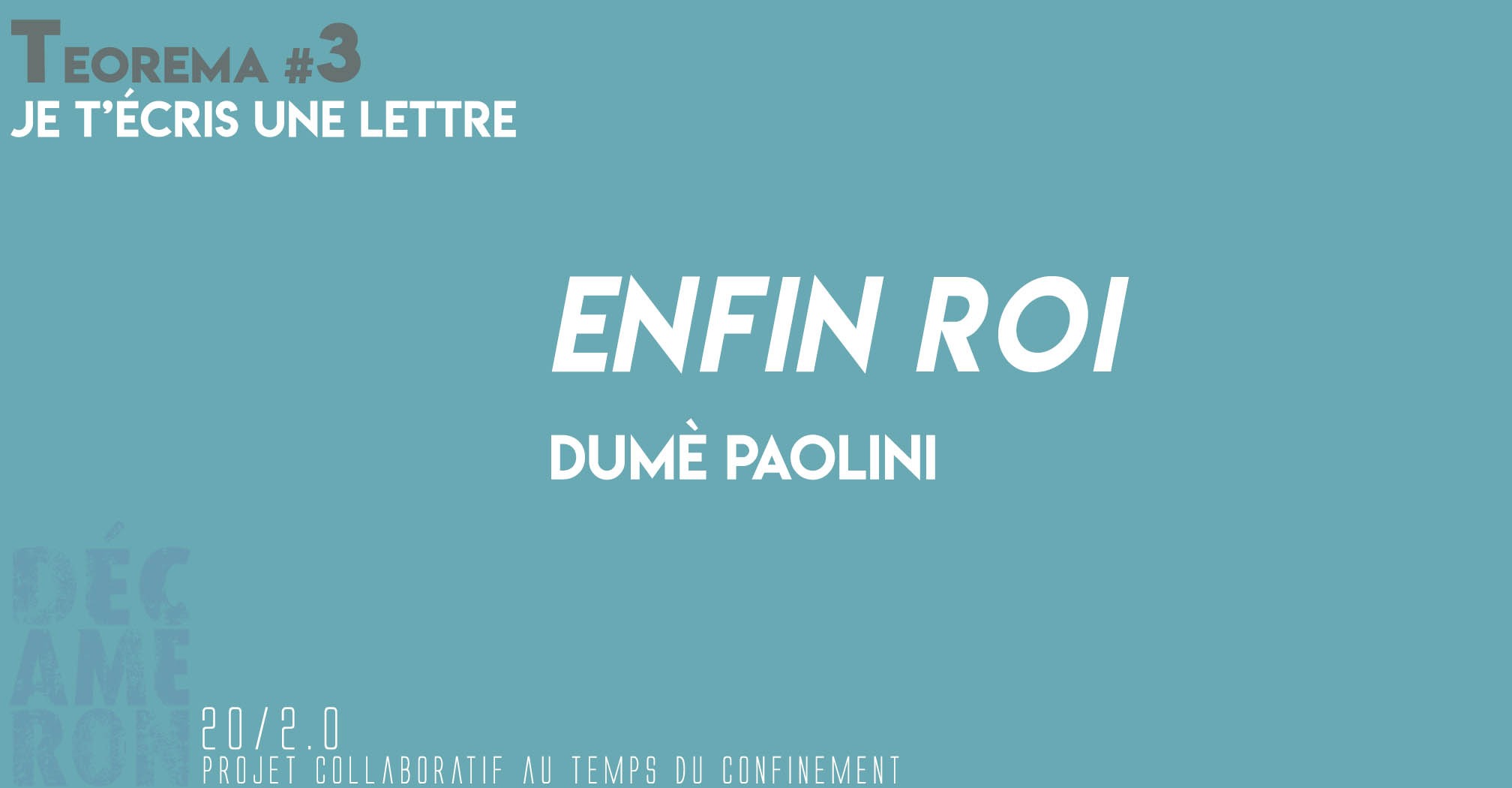
À toute chose malheur est bon… Dumè Paolini profite du confinement pour quitter son encombrant « moi d’avant » et goûter à nouveau à la vie ici-bas…
Enfin roi
Cher,
Je pensais que tu me manquerais, je pensais que je ne pourrais vivre sans tes excès, sans ta passion et ta frénésie. J’avais sombré dans un deuil abject, m’efforçant de redessiner un avenir hors de ta portée, plus doux, plus plat mais tellement fade. J’ai tant cru que tu avais raison, que c’était toi la matrice, l’étalon, que tout le reste m’a fait douter. Ces derniers longs mois ont été une pure torture, une pré-mort dans laquelle j’ai seulement réussi à ne pas me tuer. Ce n’est pas si mal. Après cette descente dans les abysses, après ces semaines de cauchemars, il me paraît essentiel de t’envoyer cette lettre pour te destituer enfin de ton trône. Trône duquel tu as toujours posé sur moi un regard sévère et acide. C’est de ce trône que tu m’as adoubé pour mieux me convertir à tes débordements. C’est de ce trône que tu m’as réduit à néant aussi. Je ne pensais pas trouver un jour quelqu’un ou quelque chose qui puisse me mettre à l’abri de toi. Et tu vois finalement, c’est ce monde tournant à l’envers et poussant de travers qui m’aura donné une nouvelle chance. Ce monde malade qui nous a cloîtrés chez nous, il m’a offert un nouveau salut, une délivrance. Moi qui me haïssais depuis des semaines de ne pas quitter ce canapé, champs de guerre ou je perdais batailles sur batailles, je me suis retrouvé avec l’invitation à y rester. D’un comportement dévastateur, la société en souffrance a façonné un acte civique. Je n’étais plus une loque avachie mais quelqu’un qui respectait les règles. Ceci est un premier point qui pourrait faire sourire, mais c’est à ces fondations déconcertantes mais tangibles que j’ai pu m’accrocher. La suite était toute tracée, il était tellement clair que mon avenir n’était possible qu’en abordant vraiment le présent. Et cette période d’isolement a fini par me livrer les outils qui me permettent de goûter le présent. J’ai enfin pu en comprendre un pan et c’est déjà merveilleux. Si tu pouvais sentir ce temps arrêté qui m’a offert un présent inaccessible. Si tu savais comme c’est bon. Je pense à ces mots que je vais t’écrire tout à l’heure et je suis serein, je ne suis même pas levé. Lové dans la couette, j’ouvre à peine une paupière de temps à autre pour jauger le jour et envisager l’heure. Bien que je ne ressente pas vraiment le besoin d’en être informé. L’heure m’importe peu aujourd’hui. Elle a perdu de sa substance. Elle menait le monde et elle n’est plus qu’une vague information de second plan. Cette graduation du temps, essentielle et orgueilleuse, orchestrait notre vie en l’écrasant de tous côtés afin de la faire plier, de lui intimer d’entrer dans des cases trop exiguës. Chronos, ton adoré dictateur, n’a fait que souiller notre liberté. Et nous, pauvres brebis aliénées, nous avons voué à ce cadran tout notre destin, nous en avons même perdu le sommeil. Pour ne rien rater, pour s’assurer que les heures défilaient aussi la nuit, nous avons inventé l’insomnie. Nos ancêtres ont sondé les jours pour en débusquer les heures et de ce don, ils ont pu s’appuyer sur une trame encore vague mais salvatrice. Il aurait fallu s’arrêter là, savoir jauger le bon équilibre, que le temps nous serve et non que nous ne le servions. A force d’affiner, de creuser, de perfectionner, nous avons fini par compter des secondes, et ces secondes, comme les minutes qui en résultent, s’appuient sur nous pour affirmer leur tyrannie, renforcer leur oppression. Nous ne gagnons plus de temps à suivre les horaires, le temps nous a doublés depuis bien longtemps et il impose sa dictature sur nos vies entières. Mais ce matin, il ne me rattrapera pas, ce matin, je n’ai rendez-vous qu’avec moi et cette lettre que je peux finir le siècle prochain, je sais que tu n’attends pas après. Je suis bien, je me sens comme fondu en ce qui constitue mon lit. Et puis, je fais encore un poids phénoménal dans ce demi-sommeil, bien trop lourd pour envisager une station verticale. J’ai le temps de le sentir, ce poids, je ne me bats pas avec, je le savoure. Il m’empêche de faire des mouvements de forte amplitude et il a, à force d’inertie, créé un espace de matière soyeuse entre mon corps et le lit. Ce n’est ni mon corps, ni le matelas, c’est une zone franche assez vague ou tout est douce confusion. Cette matière dos-matelas apporte une vraie sensation de bien-être dans son absence de délimitation. Mon corps en osmose s’essaie à quelques mouvements tests. Mais personne n’attend après moi, et toi, tu ne peux plus me faire courir dans tous les sens. Je continue l’expérience et bouge doucement pour réveiller les cellules de la zone dos-matelas afin qu’elles se dissocient, que chacun reprenne ses marques. Je pourrais me lever maintenant, écrire de suite tout ce que j’ai à te dire. Mais non, je vais juste laisser mon esprit me stimuler par quelques souvenirs matinaux au parfum de pain grillé. Je vais le laisser échafauder le bonheur d’un petit-déjeuner gourmand. Doucement, il pèse l’intérêt, le besoin de me laisser me déployer, de m’offrir à nouveau de vraies jambes, de vrais bras. Je vais attendre que mon désir de café détrône celui de rêvasser dans cette chaleureuse harmonie, attendre que mon poids diminue doucement. Je m’étire et chacun de mes étirements tentent de me désincarcérer, mais rien n’y fait, dès que je me relâche, je me fonds encore un peu mieux dans cette matière dos-matelas. Comme c’est bon de s’abandonner à cette lascive ivresse. Et comme c’est bon, de n’en sortir que pour rejoindre un autre plaisir. Même en congés, je n’ai jamais goûté avec une telle délectation ces plaisirs simples. En vacance, nous sommes encore les victimes d’un programme, d’une organisation. Même dans un matin volontairement sacrifié à la grasse matinée, il subsiste les traces profondes d’hier et l’ultimatum couvant des heures prochaines. Alors que ce matin, au milieu de ces jours libres de toute amarre, le ciel est limpide et ma journée aussi. C’est une espèce de grand vide hypnotique. Rien n’est prévu, il n’y a rien à prévoir. Et quand je dis que le ciel est limpide, c’est incroyablement vrai, pas un avion n’est venu rayer l’azur. Il appartient aux oiseaux, rien qu’aux oiseaux et à nos yeux. Rappelle-toi, enfants, comme nous regardions les rares avions qui égratignaient le ciel de leur sillon blanc. Si nous les observions ainsi, j’imagine qu’il y en avait peu, enfin j’imagine qu’il y avait des moments ou le ciel crachait tout son bleu sans la moindre rature. Et puis, il y en a eu un peu plus et encore davantage et puis le ciel est devenu sale à tout jamais. Il ne faut pas oublier de le regarder ce ciel bleu, maintenant, car il est l’objet rare d’une histoire éphémère. De mon lit, je le vois, encore une excuse pour attendre un peu. Mais la faim finit par me pousser hors du nid. Je m’habille de mes fripes préférées et confortables. Le douillet a vaincu la mode, je mise sur le bien-être, je ne sais même plus où sont mes jeans, ancien maîtres aujourd’hui déchus de ma garde-robe. Je rejoins la cuisine et décide de dédier un temps non négligeable à la préparation de mon petit-déjeuner. Un temps non compté à son élaboration, le temps d’en faire l’évènement de ma matinée. Je le prendrai dehors, sur le balcon, au soleil, et il durera des heures, la journée peut être. Mon petit-déjeuner sera ma profession du matin. Si le déjeuner n’est pas content nous le repousserons à ce soir, et si le dîner en prend ombrage, nous le déclarerons annulé. Depuis que tu as perdu ton emprise sur moi, j’ai repris la gouvernance de mon espace-temps. Bien caché au quatrième de cet immeuble, favorisé par les évènements, j’ai d’un coup d’État, improvisé un royaume dont je suis à la fois le sujet et le roi. Un coup d’éclat, devrais-je dire, car je peux défier les heures sans la moindre injonction, les laisser couler, et y suspendre ce qui m’enchante. Et je laisse se dissiper tous ces instants que je m’offre sans souffrir de les perdre. Tu m’as convaincu très tôt de façonner ma vie dans l’urgence, de ne pas gâcher la moindre minute. Tu m’auras poussé à une foule de stratagèmes épuisants afin de martyriser mon temps, de le modeler en vain. Il m’aura fallu un demi-siècle pour comprendre comme il est essentiel et jubilatoire de s’offrir des heures vides et pauvres pour être riche. J’ai bien quelques tâches à exécuter, mais pourquoi aujourd’hui ? Demain ou après-demain, ce sera très bien, peut-être même plus tard encore, qu’en sais-je ? Pour l’instant je me concentre sur mon petit-déjeuner comme s’il était d’une importance capitale. Jamais tu ne m’aurais laissé me perdre dans une telle débauche de temps dilapidé. Mais du coup ce petit-déjeuner est royal, c’est moi le roi dorénavant. À chaque bouchée, je laisse mes papilles œuvrer au plus profond de leur art et reprends encore, les yeux fermés, la liste des saveurs originales abandonnées au délicieux mélange. Mon café n’a jamais été aussi intense, il fume et m’enivre, c’est le café des pubs ou celui des films, le café qui fait vibrer tout l’écran de ses effluves. Je pensais qu’il était trop complexe à concocter. En fait, son ultime réussite tient d’abord à la manière de le boire. Il trouve davantage son arôme dans mes dispositions à sa dégustation que dans les méandres de son élaboration. Combien de petits-déjeuners m’as-tu fais expédier comme une mauvaise rengaine ? Combien de tartines et de cafés avalés précipitamment, directement jetés aux oubliettes.
J’ai étendu mes jambes et je profite de ce temps suspendu. Je ne sais pas ce que je vais faire après, je ne sais même pas l’heure qu’il est. Je déguste ce vide, ce rien qui veut bien m’attendre. C’est un instant de bonheur ou j’offre à mon corps de résonner des plaisirs à peine passés. Chaque bouchée, chaque gorgée a l’occasion de murir dans ma mémoire et de faire vibrer encore mes sens en un langoureux souvenir. Quand il s’estompe, je finis par bouger. Je fais défiler quelques news, sans grand enthousiasme. Le monde attendra aussi, il n’est pas urgent de savoir ce qui se passe. Déjà parce qu’il ne se passe pas grand-chose en ce moment et ensuite, parce que nous avons du temps devant nous, encore beaucoup de temps avant que la société ne nous reprenne en son flux tumultueux. Je laisse donc de côté toutes ces informations anxiogènes qui remuent un humus qu’il faudrait laisser enfin reposer. Quel que soit la situation, les journalistes, eux, grattent la poussière, il faut qu’elle lève, qu’elle parte en bourrasque, en nuage fétide, qu’elle nous salisse. Mais aujourd’hui, je m’abrite chez moi, je ferme les fenêtres de l’actualité, je me protège. J’ai le droit de me mettre à l’écart car je connais la vérité, je sais pourquoi je suis ici et pourquoi je ne peux être ailleurs. Et qu’est-ce qui peut bien se passer dans ce ralenti de la vie ? J’en sais assez !
Le post d’un ami me guide vers un clip musical que je découvre avec plaisir, je ferme les yeux et m’envole avec lui. Je trouve un second morceau, puis un autre. Je vogue sur cette océan musical que rien ne vient troubler. J’écoute cette musique sans la brouiller d’une autre potentielle action simultanée. J’ai abrogé tes lois de l’optimisation. Eh oui, tu ne m’aurais pas laissé écouter un morceau sans ajouter une petite réflexion, sans occuper un peu mon cerveau d’une autre cause. Mais je crois que ces pensées entremêlées n’ont jamais servi qui que ce soit. À tout mélanger, on ne fait que tout rater. Là, au creux de moi, la musique occupe l’intégralité de mon conscient, je ne pense même plus, je me gorge, je bois cette mélodie. Je suis accroché à chaque note et suit la chorégraphie qu’elles forment toutes ensemble. Je ne sais combien de temps s’est écoulé, mais c’était délicieux. J’ai laissé mon esprit en paix pour qu’il s’abandonne à cette musique. Cela me parait prodigieux de se concentrer sur une seule chose, sans être bousculé par une autre. C’est une nouvelle sensation, une espèce d’intimité singulière. J’avais perdu dans cette course passée que tu m’imposais, l’écoute pure, la vision originale, le goût entier. C’est sans doute quelques bribes instinctives d’une antique existence qui reviennent se frotter à moi. À moi de les accueillir, de les aborder avec ouverture. Je n’aurais peut-être pas d’autres occasions de me connaître mieux. Des portes s’ouvrent parce que l’univers a changé et surtout l’espace-temps. Ce sont des portes ouvertes vers la vraie nature des choses. En courant avec toi, en pleine compétition, toutes ces années, j’ai perdu une partie de mes sens et surtout le sens de ma vie. Je sais que pour toi le seul monde qui vaille sera toujours le monde d’hier, mais pour moi, aujourd’hui est l’occasion de faire connaissance avec ma vraie nature et de retrouver ma sensibilité enfouie. Sensibilité au mots, aux parfums, aux couleurs, aux goûts, et surtout au temps. L’oisiveté, ce que tu nommerais choléra de notre temps, pourrait reprendre du galon. C’est une digne activité, bien que tu m’aies convaincu des années du contraire. C’est une des bases de notre équilibre, son éradication une des raisons de notre dépression.
Même en t’écrivant maintenant, je peux divaguer sur tous les chemins de mes pensées, le temps n’a pas borné cette lettre. C’est tellement bon qu’il s’étire ainsi, que rien ne vienne bousculer mon esprit en plein vagabondage. Il se promène, sans barrière, ne se rappelle d’aucun principe castrateur et livre ses vérités en offrande. Et moi, je fouille, je pétris et en extirpe les humeurs de ma vie. Pour le moment j’ai décidé de t’écrire, mais je pourrais tout aussi bien arrêter, m’assoir derrière la fenêtre et regarder les goélands. Je vais d’ailleurs aller manger quelque chose et après je me fendrai d’une petite sieste, une petite sieste en abandon, sans téléphone, sans réveil. Ce sera une totale désertion, un laisser-aller manifeste. Je me souviens de toutes ces siestes gâchées, que tu me faisais caler entre deux horaires, leur fin définie les mutilait à mort. Rien qu’en réglant ce réveil castrateur, je gâtais ma détente, je remontais les ressorts de mon inconscient. Ainsi, d’un moment qui aurait pu être un vrai repos, je fabriquais malgré moi une attente organisée et nerveuse. Mais aujourd’hui, il n’y a ni réveil, ni sonnerie tapageuse, aujourd’hui, il y a un océan de rien, et je vais y plonger.
J’ai tellement dormi ce matin que cette sieste est une démesure. J’attrape un livre déjà débuté et le parcoure à nouveau. Un paragraphe me touche et je ressens de petits picotements dans la nuque. Je laisse tomber mes mains et le livre qu’elles portaient sur mes cuisses et je ferme les yeux. J’ai envie de célébrer cet écrit. Je l’ai pris en affection, je le digère comme un met exquis, après tout, il est à moi maintenant. Je peux en jouir pleinement. Je repense à tous ces livres que tu m’as fait survoler sans vraiment les lire. Ils n’ont offert à mon esprit que les miasmes amers de sujets incompris. Visités en diagonale, ils ont glissé sur moi. Et toutes ces pensées spirituelles et idéologiques que des cerveaux affûtés ont tissées avec force et conviction n’ont été que nourriture fadasse faute d’avoir pris le temps de la mâcher, de la digérer. Ces lectures du soir, tu aurais pu me les laisser, ce n’était pas du temps perdu. Mais non, il t’a fallu me détourner de tout, ne rien laisser exister dans son entièreté. Dorénavant, je me laisse prendre en otage de ces récits d’autres vies, je les rejoins. Je n’ai lu que quelques pages, mais je les ai vraiment appréciées, je m’en suis délecté. Tu m’imposais de lire uniquement pour avoir lu, parce qu’il faut lire, mais finalement sans lire vraiment. Depuis combien de temps n’avais-je pas lu en suivant chaque mot, en en mesurant l’impact, le sens, la poésie ? Je souris de cette nouvelle découverte, de ces mots partagés, je souris et je m’assoupis quelques minutes.
Je t’ai abandonné un peu, je suis allé marcher, renifler les parfums du printemps naissant. J’ai attrapé une casquette, des lunettes de soleil et ai descendu les quatre étages à pied. C’était déjà très agréable de voir défiler ces paliers, que, bloqué dans le cachot de mon ascenseur, je ne voyais jamais. Je descendais, trottinais comme un enfant pour entamer cette récréation bucolique. C’était un cadeau cette sortie, un souffle. Je me suis dirigé vers les crêtes au-dessus des immeubles voisins. Un chemin quitte les cours d’immeuble pour serpenter dans les arbustes et les figuiers de barbarie. C’est un sentier raviné qui monte au-dessus de la ville et nous donne prestement la sensation que nous en sommes loin. Comme un leurre, cette nature, cette vue sur la mer et la chaleur particulière, nous peignent un paysage de grande randonnée. Si près de chez moi, je suis en pleine montagne, dans un maquis en fleur. Je me suis arrêté plusieurs fois. Parfois pour le paysage, ses vues imprenables sur le golfe et ses eaux calmes, parfois pour un buisson gonflé de fleurs aux senteurs exubérantes, parfois tout simplement pour m’assoir. Aujourd’hui, croisant un rocher accueillant, je stoppe mon ascension pour me poser un peu. Je profite de ce petit moment en accord avec les éléments. J’ai souvent parcouru cette piste avec toi, courant après le record, montant en sueur, obsédé par le sommet. Combien de fois suis-je passé au milieu de ces senteurs, devant ces paysages merveilleux, combien de fois ai-je fui parce que j’étais déjà dans l’après ? Tu me faisais courir après la prochaine heure, me débarrasser de celle en cours sans trop considérer son charme. Au milieu du trop, et pire, du trop vite, il n’y a de place pour rien. Je n’ai pas vécu, je me suis débarrassé de la vie. Je pèse depuis peu la valeur du presque rien, je pèse comme il peut être grand et beau, comme il peut être important bien qu’infiniment petit. Je pèse comme il peut défier l’après et ses comptes à rebours. Je reste béat, sentant la chaleur m’envahir, les parfums me cerner tour à tour, fleurs, feuillages et pierre. La pierre a son parfum, si l’on prend le temps de l’exhumer de la brise. Parfois, c’est d’une petite bourrasque soulevant une fine poussière qu’on peut l’appréhender. La pierre a son parfum, mais il faut tant d’application pour y gouter que nous rejoignons en hâte les fleurs faciles. Je me suis assis sur un banc, posé au détour d’une épingle du sentier. Je me suis concentré sur les bruits de la nature et sur mon souffle. J’essayais de ne pas penser à la fin, à mon départ de ce lieu. J’essayais d’y respirer comme si j’allais y respirer une année, d’en faire intimement partie. C’était un précipice de sérénité, il y avait juste à se servir. Comment as-tu osé me couper de tous ces délices, de toute ces menues saveurs, charmantes et accessibles ? Comment ai-je pu courir si longtemps sans me retourner ? Je suis redescendu tout sourire de cette petite virée aux parfums de renaissance. Je suis remonté dans mon appartement, heureux de cette parenthèse. J’en ai profité pour m’assoir, en tailleur, et assimiler doucement les petits bonheurs qui ont étoilé ma marche et ses arrêts. Une petite méditation, en cette après-midi infinie.
À notre libération prochaine, je vais continuer sur cette route, je ne te rejoindrai pas, je resterai confiné de toi. J’ai compris qui tu étais et j’ai compris ce que tu avais fait de moi. Je me soigne, j’apprends à vivre une vie plus petite, mais une vie où l’on ne gâche pas tout. J’apprends à vivre l’action présente sans la livrer en pâture à la suivante. J’agis en pleine conscience en sentant ce que je fais. J’ai fermé les portes à ce futur prétentieux et racoleur. Il viendra bien assez vite. J’apprends le présent comme les petits du CP. Tu n’as pas ta place dans ce nouveau concept de vie. Je te connais trop bien, tu ferais mine de t’y conformer quelque temps pour mieux me corrompre ensuite. Bien que je ne désire pas me perdre dans l’ambivalence d’une schizophrénie nauséabonde, j’ai dû accepter ton existence pour mieux me dégager de toi. Alors, soyons objectif, maintenant il est l’heure de te tuer. Si tu ne vis pas en moi ou vivras-tu ? Tu es moi, j’en suis conscient, mais le moi d’avant, un moi qui n’a plus cours. Tu as été un moi fulgurant, passionnant, mais j’ai trop de plaies encore béantes, séquelles de tes folies. Alors laisse-moi, en ce jour du 20 avril 2020, jour de mes 51 ans, te dire adieu avec aplomb, avec conviction. Je ne reviendrai pas et ne te laisserai pas revenir. Je déclare sur l’honneur, que tu n’existes plus, que je suis seul parce que je suis un autre.
Pour lire un autre texte de l'auteur : Les abysses
Entamez un dialogue : écrivez-lui à notre adresse decameron2020@albiana.fr, nous lui transmettrons votre message !


















