- Decameron Libero
- 3 likes
- 1790 views
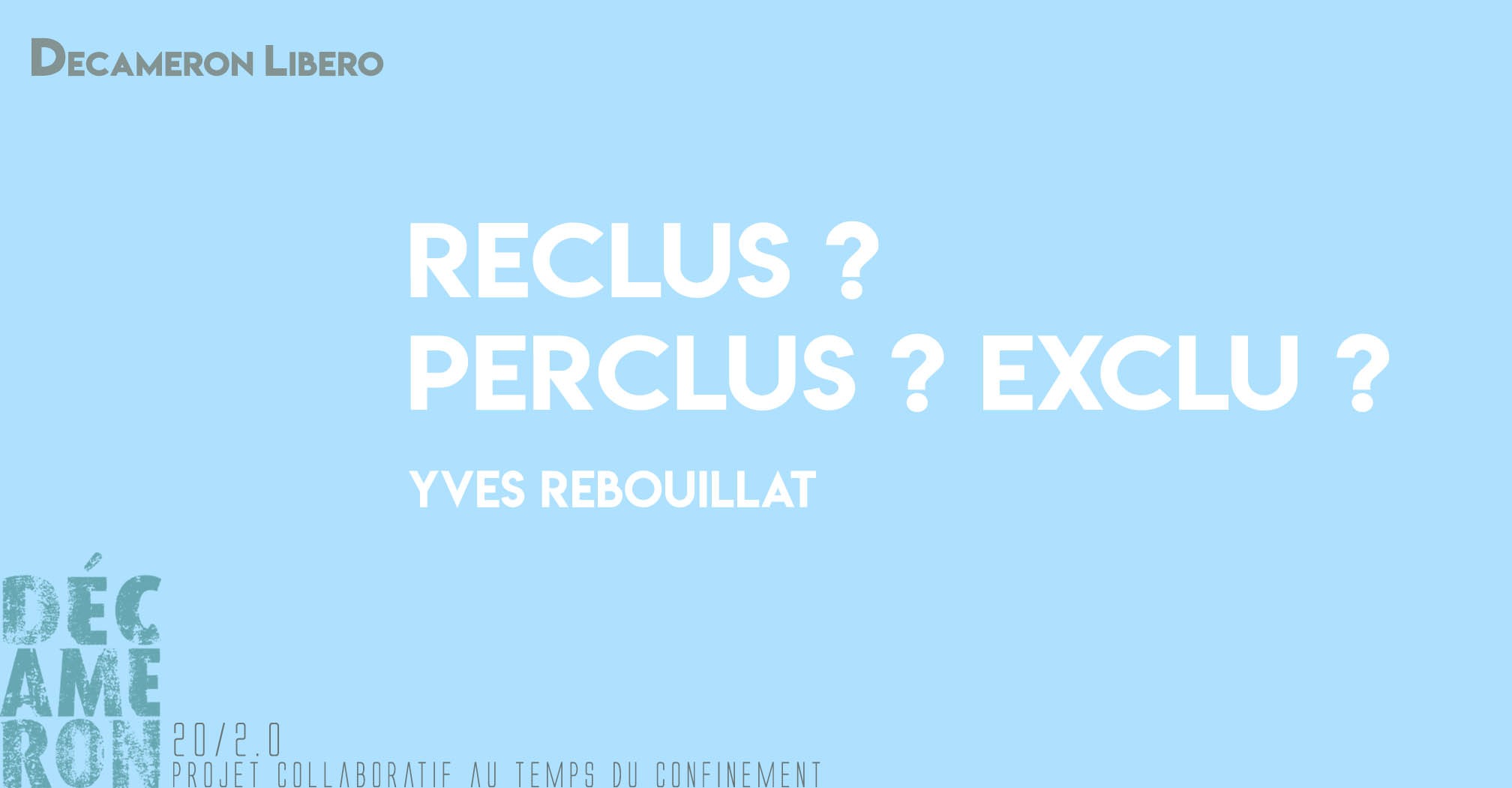
Yves Rebouillat conclut 48 jours de confinement : quand même, voir les autres… ce n’est pas rien !
Reclus ? Perclus ? Exclu ?
Que dire au matin du 48e jour de confinement ?
Que dans mon exil occitan, volontaire et confortable, expliqué par une succession de concours de circonstances et de décisions plus ou moins opportunes, il arrive que je me sente... seul.
Que je suis un confiné occupé, récompensé au bout de nombreux et multiformes échanges, téléphoniques, visiophoniques, messages-smartphoniques, épistolaires et informatisés. Avec une compagne éloignée, veillant sa mère, des enfants retenus en Californie et en Nouvelle Aquitaine. Avec Albiana, éditeur de génie, inventeur du concept et de la pratique partagée qui va avec, de l’auto-littérature pour tous. Sorte de philtre d’évasion dématérialisé, transmissible par lettre électronique et qui relie non seulement les partisans dudit genre, mais tous ceux qui ont besoin de réduire la coupure d’avec l’humanité en parlant à une petite part de celle-ci, donc en lui écrivant. Récompensé, disais-je, par les échos courtois, cohérents, croisés aux propos, sentiments, points de vue de chacun disant que nous sommes et serons indéfectiblement liés.
Qu’habitant la campagne, je jouis des privilèges de pouvoir marcher alentour, longeant les champs, uniformément verts – dépourvus des marguerites, des bleuets et des coquelicots qui faisaient jadis leur charme et les bouquets offerts à ma mère –, d’arpenter les chemins qui serpentent et dévalent au gré des reliefs d’ampleur limitée par une implacable logique géologique : ma maison est bâtie sur un plateau. Avec ondulations, talwegs, replis et petits bois en creux, mais, au demeurant, plutôt plat. Moins, « surprenamment », qu’une mer, même agitée, houleuse, que j’évoque, tant le confinement me rappelle ces marins intrépides qui trépignent d’impatience, bloqués, mal calés au port, avant d’entreprendre une longue course océanique et ont besoin que ça balance un peu sous les pieds et que la ligne de l’horizon le plus lointain possible, se confonde avec les flots. Mon plateau immobile se creuse et se bosselle, avec des amplitudes de faibles à hautes. Pas la mer à boire qui, elle, sait être plate ou d’huile.
Qu’à espérer voir, en me baladant, des abeilles vrombissant, butinant ou volant sur place, qu’à chercher des insectes qui ne virevoltent plus autour des petites fleurs communes, bleues, roses, jaunes et blanches, qui poussent parmi les hautes herbes, dans les rares terres en jachère et sur les bas-côtés des routes à tracteurs lourdement équipés et des sentiers des randonneurs qui respirent toujours..., je perds mon temps.
Qu’à photographier les hampes des blés, les fleurs d’aubépine et d’amandiers sauvages, celles vanille-fraise des chèvrefeuilles, mêlés aux ronces, aux chênes chétifs, aux acacias des haies champêtres, aux buis ravagés par la pyrale, désertés par les coccinelles, dépourvus de nids d’oiseaux dont les piaillements sont muets... je n’y trouve pas mon content. Qu’au moment où les animaux sauvages entrent dans les villes, ici, les petites bêtes ne sont pas revenues en grand nombre des campagnes répétées d’épandage chimique.
Que je lis des romans. Littérature blanche et noire. Bouquins d’hier et récits d’aujourd’hui. De la sociologie sur "l’Altérité". De la philosophie politique, subversive et conservatrice. Le Nouveau Magazine littéraire...
Que j’entretiens le jardin entre deux averses, que je fais le plus vite possible, tous les dix ou douze jours, des courses alimentaires.
Que je prends le temps de penser, d’écrire, de m’entourer de précautions élémentaires, et le Covid-19 au sérieux, le soupçonnant d’être à l’affût, prêt à se faire catapulto-postillonner au visage de quiconque ne serait pas suffisamment prudent, ou attendant patiemment, posé sur un objet, une surface, le quidam qui y posera la main puis la portera à ses lèvres, puis, de proche en proche... Je ne donne pas dans la panique, mais j’entends les exposés sur les "gestes barrières" et les affres dans lesquelles se retrouvent les personnes atteintes.
Que 48 jours, c’est long ! Depuis l’instauration de la Grande Suspension, pas une seule personne passée par la maison, aucune visite de ma part chez qui que ce soit.
Que je redécouvre la nécessité de la présence des autres, l’urgence de garder, cultiver, développer des liens avec eux. Qu’entendre et voir en image ceux qu’on aime encore, est frustrant, cruel. Que j’ai envie, besoin, de les regarder et de les écouter sans intermédiaire. De les toucher, caresser, sentir. Éprouver physiquement leur souffle, entendre leurs soupirs. Les aider à passer un vêtement, leur tenir la porte, cuisiner à leur intention un petit plat rare. Leur servir un verre et boire de concert, parce que trinquer est autre chose qu’entrechoquer des verres à moitié emplis d’un bon vin, prélude au plaisir du goût, c’est faire le plein de connivence et de paix.
Que rire seul, n’est pas marrant, comme d’une nouvelle lubie langagière découverte en écoutant la radio (celle qui suit n’est pas récente mais se répand comme un virus, elle est considérablement hilarante : introduire dans un commentaire une petite formule – de deux à quatre mots – en langue anglaise et aussitôt la traduire en français ! Impayable, non ? Le comble de l’imbécile non nécessairement inculte ou bilingue, jouant au malin et chutant lourdement). Non plus se moquer seul d’un journaliste de radio ou de télévision qui traite d’un sujet qu’il ne maîtrise pas, écouter sans témoin du Chostakovitch ou du Gershwin, mais taire l’expression du plaisir que j’en retire, ou rire jaune et offusqué en prenant connaissance de la dernière crétinerie du président américain. Je ne peux tout de même pas, dès qu’un mot, une image, un événement, me fait réagir au-delà d’un certain seuil, me saisir du téléphone, déranger quelqu’un pour lui raconter que j’ai beaucoup souri et grincé des dents et que j’y avais d’excellentes raisons. Du coup, je réfléchis à l’utilité de rapporter ce que je ressens et risque de prendre le pli de me taire quand la cloche du déconfinement retentira, jours d’après compris.
Une haie entoure la maison. Formée de lilas, de buddleias, d’arbousiers de maints arbustes à fleurs, viornes, spirées, seringats... Au cœur du jardin, des massifs avec des iris multicolores, des cistes, des lavandes, du jasmin, des valérianes et des plantes qui fleurissent dont je n’ai plus les noms à l’esprit.
J’ai vu des enceintes et des cours de prisons moins jolies, moins embaumantes et je me rappelle ce vieux feuilleton anglais, élégant, de la fin des années 1960, “le Prisonnier”, cherchant à fuir le “Village” où tout était si propre et si joli mais dont personne ne pouvait s’échapper... jusqu’au quatorzième épisode.
Ai-je rêvé de ce couple de mes amis acceptant hier, de se rendre à mon invitation, chez moi, moins pour célébrer un événement que pour le plaisir d’une nouvelle première rencontre (autorisée et avec les “bons gestes”), en chair, en os et en “3 D”, le mardi 12 mai, lendemain probable de notre déconfinement et dans le même mouvement de libération, m’invitant à dîner trois jours plus tard ? De quoi me réconcilier avec tous mes choix passés, dont celui de vivre ici... loin du monde.
Pour lire d'autres textes de l'auteur :
Un Sosie à Zo(n)za ou "La jeune femme endormie"
Entamez un dialogue : écrivez-lui à notre adresse decameron2020@albiana.fr, nous lui transmettrons votre message !

















