- Decameron Libero
- 2 likes
- 1736 views
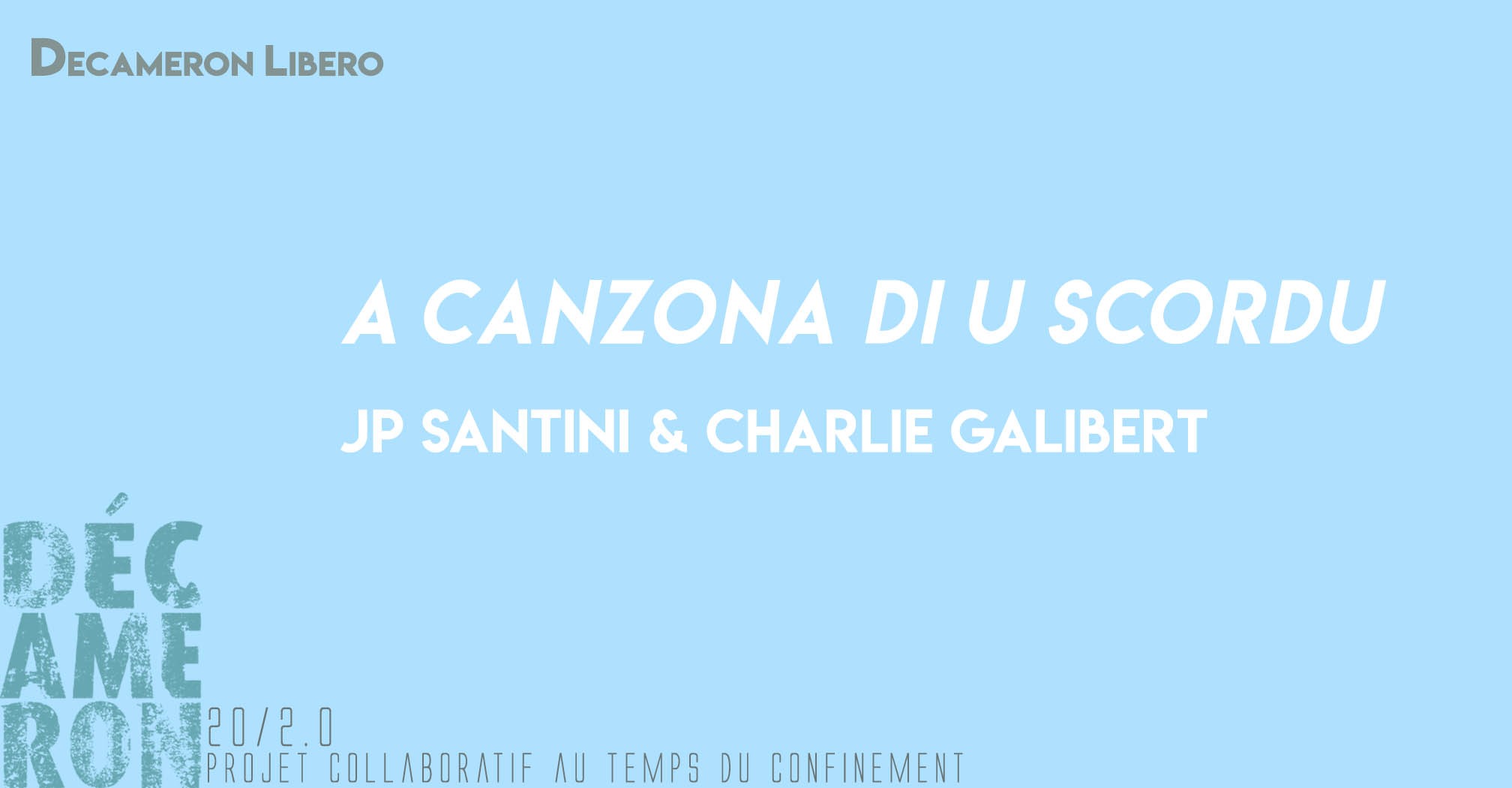
Entre Nice et Barrettali, se joue un chjam’è rispondi inquiet, un chant de l’oubli…
« A canzona di u scordu »
Jean Pierre Santini & Charlie Galibert
* * *
Feu l’auteur
Philippe-Antoine m'avait bien dit que cette histoire finirait mal. On a beau le savoir, on n'y croit guère. Et quand ça vous tombe dessus, c'est comme l'amour. On crie au miracle, on se dit qu'on est le plus heureux du monde, on déclare sa flamme dix fois par jour, bref on s'éternise dans la niaiserie jusqu'au jour où le charme se dissipe.
– Tu verras, disait Philippe-Antoine, quand le rythme de la fornication diminue, tu reviens vite à la réalité.
Je m'en doutais bien pour avoir eu des expériences en la matière. Et il en faut de la matière pour les histoires d'amour.
Là, c'est autre chose. La matière commence à faire défaut. On est un peu pris au dépourvu. La parole s'absente, mais pas les mots qui continuent leur sarabande dans le for intérieur. Vu les circonstances, « le for intérieur », c’est difficile de trouver mieux comme expression.
Je suis taiseux, mutique, sans voix, mais j'ai encore voix au chapitre. Et ce n'est pas le dernier parce que ça chuchote drôlement dans ma tête.
Mes amis d'enfance m'ont soutenu jusqu'au bout. Ils s'y sont mis à plusieurs parce qu'on pèse plus lourd qu'on ne l'imagine dans de telles circonstances. Ils souffraient un peu mes potes avec lesquels je faisais autrefois des parties de volley sur la place de l'église.
C'était le bon temps. On ne s'en rend compte que plus tard, quand les jours sont passés et qu'on idéalise sa jeunesse. On se sentait fort. On avait la vie devant soi. C'est beau les formules. Ça aide à passer le temps sans qu'on s'en aperçoive.
Le bon temps ?
Perdure l’idée des souvenirs générationnels se succédant, nous traversant, la tranche de vie que représente l’empan des grands-parents aux petits-enfants et, pourtant, et en même temps, ainsi qu’à pleines mains de toutes ces vies, la relativité de cette continuité, ce déroulé, cette fuite aussi, et la relativité absolue de chacune de ces vies singulières.
Sentir, faire ressentir l’irréversibilité de la mort, là, toujours-déjà là, avant, après, dessus, dessous, dans le moindre rayon de soleil happé par une main, un œil, le moindre verre d’eau bu, chaque nuage, chaque nuage singulier de chaque jour singulier, de chaque jour de chacun de nous sur ces générations enfilées comme un collier à la fois insouciant est cependant responsable, l’irrémédiable, le Seul Définitif pour tous et chacun, de la mort, notre ontologie, chacun d’être-pour-la-mort. Le meccano affectivo-cognitif-social existentiel que nous construisons tous et chacun en nous appuyant et chancelant les uns sur les autres. Et nos imaginaires brutalement mis à plat par le malheur.
Nos enfances uniques, et cependant se répétant.
Nos morts se répétant et cependant uniques.
La peur transie de ne plus ressentir, ne plus éprouver l’envie de prendre dans ses bras. Ne plus avoir envie d’aimer, sans qu’il soit question d’usure de l’amour, ou de la capacité d’aimer, mais plutôt des atteintes de l’âge, de la vieillesse accourue au-devant une adolescence qui a perdu son éternité.
Qui d’autre que moi aura été cette oiselle qui serait née d’un chat, ce chat qui serait né d’un oiseau ? Comment donner à entendre, voir, sentir, ces êtres - dont nous sommes, dont TU es, dont JE suis - infiniment étirés dans le temps et l’espace et cependant réduits à ce point-ci de l’espace et du temps – un simple anneau. Comment se promener dans ses « moi » et émois ? Tous ces fers et ces bois.
Impressions, sensations à peine perceptibles, évanescentes, fluentes ; ces visages, gestes, voix, regards, ces saisons, ces travaux.
Synchronie du bercement des regards, des partages, diachronie des apprentissages, des étapes. Ces deux axes faisant comme une croix où nous nous crucifions. Croix en dérive, debout, couchée, dans le fleuve sombre et si rapide et tumultueux, dévorant, ennoyant, dans l’irréversible, le glissement de tous et de chacun, suivant son avance en âge, dans le temps qu’il porte en lui, suivant sa vitesse et son rythme propre, vers le vieillissement, le ralentissement, l’arrêt sur image, l’affaiblissement, la maladie.
La mort.
Comment dire, écrire, pincer doucement, caresser, dans la Grande Maison de notre temps les étages familiaux générationnels, les étages des maisons singulières, les étages des saisons, les initiations, les départs, les retours.
Le Départ.
Et chacun de nous singulier dans cette immense mécanique giratoire et fléchée, entropique, grain de sable (mais à Giorgio), goutte d’eau (mais à Sainte Suzanne), brin d’herbe (mais à Aoussil) avec ses sensations à saisir, noter, intenses, le jardin dans la nuit, chaque nuit, chaque nouvelle nuit, et Chaque Nuit de la Grande Nuit, le souvenir des regards, des voix, les moments uniques, disparus, en allés, et pourtant tout charme toujours là, frémissant, pressant, fantômes avides de notre amour et avides de nous aimer, l’espoir mêlé à la conscience de l’irréversibilité, les belles choses qui s’en seront passées, les belles choses qui vont rester, les belles choses assises ou deboutes, là, devant nous, dans la nuit de la chambre ou du jardin, les manquements de chaque instant, le pris, le laissé-passé, le manqué, le perdu, le manquement des essentiels, les nostalgies, les regrets, l’envie soudain jaillie, jeudi soir, de travailler de mes mains dans le hangar géant du carnaval, coulisses multicolores, pluri sonores, poly odorantes, supra sensitives, extra sensuelles, des Grands Chars s’éveillant à leur vie comme des premiers nés d’un instant seulement, seulement éphémères, comme d’autres parmi nos anciens entrèrent en labour, aux Emminades, partirent le cœur brisé à la ville, se jetèrent dans un puits ou s’aimèrent d’amour à l’Escampadou.
Enfants maigres orphelins agitant leurs yeux immenses dans le sac d’os de leur corps, enfants obèses élevés sous la mère, devenus adipeux-rois.
Pourquoi nos regards ne se mélangent-ils pas quand ils se rencontrent ?
Le pays disparu
J'écris un pays disparu, dont je serais la dernière survivante, heureuse ainsi, mais, néanmoins, à la recherche de frères et de sœurs égarées, car ce pays est celui d'une enfance révolue, dévastée par le monde et le temps, colonisée par les nouvelles cultures de rapport et les citadins en fuite venus monter des murs à la campagne. J'écris un pays dont j'ai conservé les noms ainsi que des arcanes, dont il suffit d'écouter la voix pour gagner une extension à l'intérieur de soi, et que je me répète à voix basse, jour après jour, pour en confirmer le charme et l'infinie ancestralité, car ces noms n'appartiennent qu’à ce pays et à moi (et j'appartiens à ce pays comme ses mots), ainsi, lorsque je disparaîtrai, il ne restera personne pour les susurrer et le pays, disparu, chantera seul, à voix basse, comme pour se bercer.
Je crois que c'est déjà le cas
Le chroniqueur des ténèbres
Des faux semblants de la vie à ceux de la mort, la porte est étroite. On trépasse et on passe aussitôt dans un monde d’une absolue virtualité. Un réseau global y tisse continuellement sa toile pour accueillir, d’un instant l’autre, les derniers disparus. Une tension murmurante en résulte où s’interpellent la multitude des voix que l’on croyait éteintes à jamais. Dans une langue originaire, ignorée jusque-là, les paroles dites sont aussitôt intelligibles. La malédiction de Babel est levée. Il n’y a plus qu’un seul langage. Il sourd de la nuit. Il ruisselle d’abondance sur les ondes radio qui grésillent et le portent. Défunts d’hier, trépassés du jour, personnages de fiction évadés des histoires contées ou écrites depuis la nuit des temps cohabitent dans un espace virtuel où les mots ininterrompus s’échangent et s’enchainent.
Mes cadastres chéris
Il m’arrive de voir mes cadastres chéris parcourus par les cohortes de ceux et celles qui, génération après génération, siècle après siècle, les ont habités et vécus, imprégnant la terre de leurs traces légères ou lourdes, selon ou selon, s’émerveillant de la poussée des arbres, du passage des bêtes, du poids du ciel et des pluies cinglantes, et pensant, au moins une fois dans leur vie, aux cohortes de ceux et de celle qui, génération après génération, siècle après siècle, les ont parcourus.
Loin d’être des fantômes, ils revêtent toujours à mes yeux une singularité, une forme humaine dans laquelle chaque trait de visage est lisible, et leurs yeux font comme des miroirs, des flaques, ils côtoient des bêtes domestiques et des bêtes sauvages, ils se courbent sur la terre pour faire pousser le pain et le vin, ils se redressent pour invoquer leurs dieux injustes, et leurs tours de reins renforcent encore leurs croyances et leurs prières, jusqu’à ce que, toute veillée, tout bal, toute baignade d’Escampadou et courses folles dans les herbes d’Aoussil enfuies,
ils se courbent tellement que la terre s’ouvre sous leur ombre et qu’ils n’ont plus qu’à la ramener sur eux,
tout leur étant souffrance,
tout leur étant oubli.
Sur interpellation d’Alice
Tu ne vas pas t'en tirer comme ça et te défiler en m'abandonnant au milieu du chemin. Tu as des comptes à rendre à tes personnages parce qu'ils ne trouveront jamais la paix. À tout instant, un inconnu peut les remettre au monde. On ouvre un livre comme une tombe. La résurrection est assurée.
Tu décides d'abord de me nommer « Alice ». C'est tellement abstrait que je ne sais toujours pas pourquoi ce prénom plutôt qu'un autre.
« Bien rangé dans ma boîte à oubli. »
C'est bien toi qui nous l'as sorti celle-là ! C'est facile de faire son malin quand on est bien vivant. Mais nous qui ne l'avons jamais été, on ne va pas t'oublier comme ça ! Je ne sais pas si les autres viendront te demander des comptes et tourmenter ta mort avec leur fausse vie. Tu n’es plus de ce monde paraît-il, mais avec toi sait-on jamais. Tu as vécu sur des faux semblants comme tes personnages courent de mots en mots, de ligne en ligne, de page en âge, jusqu’au point final.
Au revoir adieu
Je vois toutes les choses me faire adieu de la main. Les collines qui m’entourent me disent au revoir adieu, en agitant leurs arbres sur leur tête ou dans leurs mains, au revoir adieu me cligne des yeux les étoiles aimées, au revoir adieu dit la mer en bas dans sa conque pareille à une main, au revoir adieu me dit le ciel jusqu’à l’enfance,
Nout me fait au revoir adieu de la main, la voûte céleste tremble un peu, sur ses trois appuis, le Mont Gozzi, le Mont Chauve, le Mont de la Salvarié me disent adieu de la main et les petits sentiers secrets où j’allais chercher le lait par des raccourcis et où me sont apparues un jour de petits êtres blancs qui dansaient et chantaient, m’invitant à venir avec eux, ceux-là même dont le visage blanc s’était penché sur moi en souriant, sur mon berceau, que je voyais ensuite régulièrement, qui m’apprenaient des langues aux mots bizarres et chantant, des mots enluminés, à participer à des cérémonies, petites figures blanches qui me souriaient, en découvrant un peu leurs dents, me font au revoir de la main adieu.
Feu l’auteur
Je m’attendais à tout sauf à ça. J’imaginais même que le repos serait éternel. Il ne faut pas croire ce que les vivants écrivent sur nos tombes. Je suis bien placé désormais pour savoir qu’il y a bien plus de rumeur ici que dans leur monde. Ça parle, ça cause, ça papote, ça bavarde, ça murmure, ça marmonne, ça balbutie, ça jargonne, ça bafouille, ça bredouille, ça devise, ça soliloque, mais ce brouhaha est spontanément intelligible. Les mots mènent la ronde et nous enchainent à une histoire qui ne nous appartient pas, que nous ne comprenons pas et dont nous sommes les personnages virtuels au même titre que ceux, fictifs, mis au monde dans le pauvre assemblage de nos écritures. J’aurais mieux fait de me taire, de ne jamais rien écrire, de ne jamais imaginer ce monde de papier dont le petit peuple me poursuit jusque dans la tombe.
JPS & CG
9 avril 2020
Barrettali - Nizza

















