- Decameron Libero
- 18 likes
- 1704 views
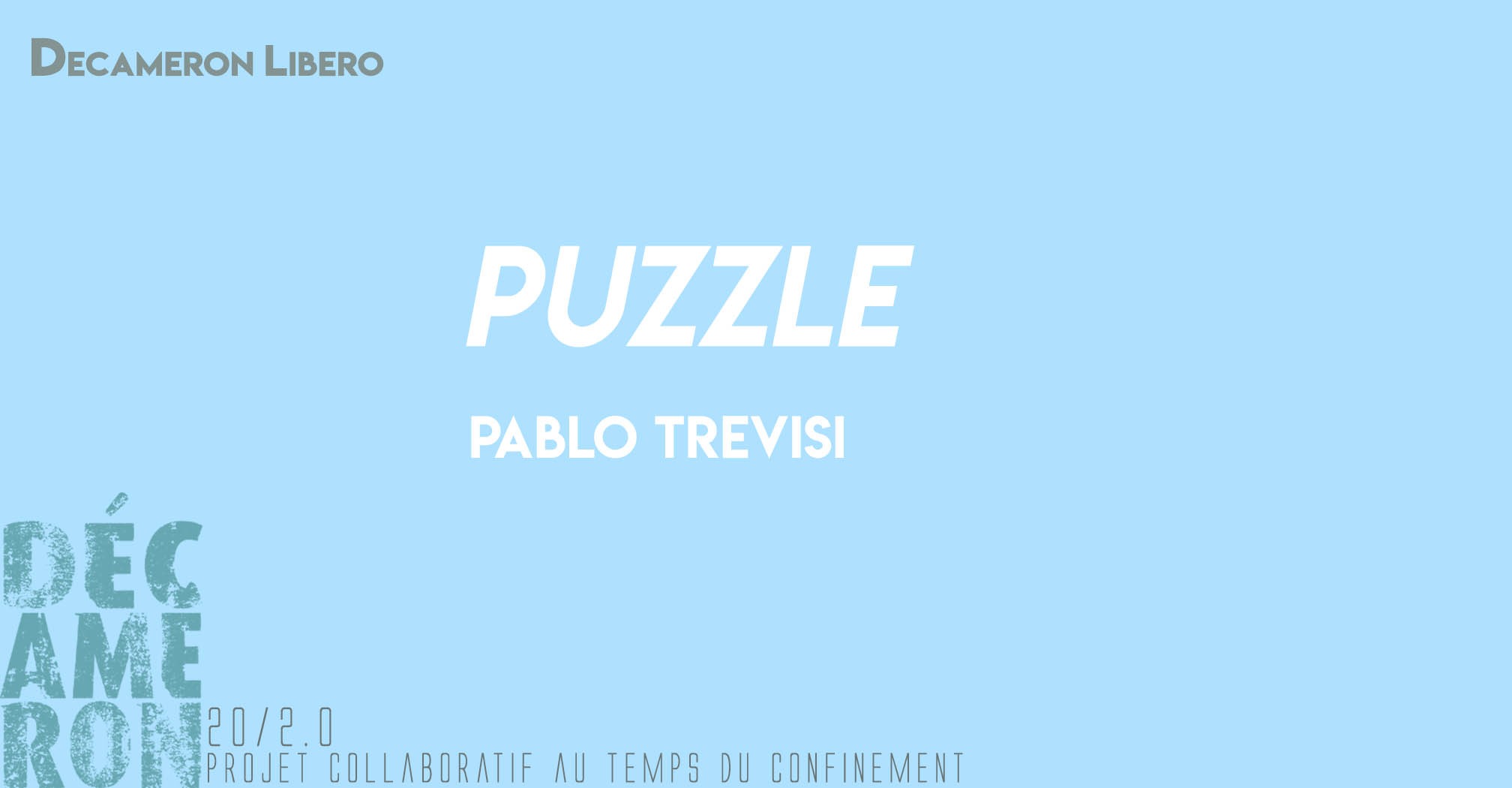
Pablo Trevisi situe sa nouvelle en Argentine, dans les territoires flous de l’enfance et de la mémoire.
[Durant la dernière dictature argentine (1976-1983), l’armée kidnappa les enfants mineurs de personnes « disparues » et les remit à des familles proches du régime. Ces familles, de préférence catholiques, s'appropriaient illégalement les enfants, à qui ils cachaient leur véritable origine en changeant leur identité.]
PUZZLE
Durant l’enfance nous n’avons quasiment pas de souvenirs, mais en vieillissant, tous les bons souvenirs viennent de l’enfance ; c’est du moins ce que j’ai lu quelque part. Je n’ai pas encore atteint la vieillesse pour vérifier cette affirmation, mais cependant j’ai un certain âge pour pouvoir commencer à me remémorer ma propre enfance.
Chaque fois que je reviens sur cette époque de ma vie, je le fais comme si j’accomplissais un rituel : toujours suivre un seul et même trajet qui m’emmène jusque-là sans heurts, ouvrant les mêmes portes que je laissais entrebâillées et fouillant les mêmes endroits que la dernière fois. Je n’ai jamais aimé les surprises. Revenir sur mon passé par un chemin que j’ai largement fréquenté a été un moyen, peut-être inconscient, de les éviter.
Depuis quelque temps, cependant, je suis assailli par des souvenirs que j’ignorais – ou que, qui sait, j’avais oublié – ; si bizarres que bien qu’ils m’appartiennent, ils me semblent étrangers ; si lointain dans le temps que bien que proches maintenant, ils me paraissent inaccessibles. Bruits, odeurs, textures me conduisent aveuglément à travers des passages secrets de ma mémoire jusqu’à des pièces dissimulées de cette enfance pure, qui à l’âge adulte m’a souvent servi de refuge.
La semaine dernière, sans aller plus loin, l’odeur d’amidon qui se dégageait de ma chemise, la même odeur que ma blouse blanche, celle que ma mère repassait chaque matin avant de m’envoyer en classe, m’a transporté à travers un de ces sombres couloirs de la mémoire jusqu’à mon école primaire, en classe élémentaire, à mes sept ou huit ans. J’étais vêtu de ce tablier impeccable, assis à un pupitre de bois sombre, verni par la saleté accumulée durant des années, sur lequel j’avais sculpté avec la pointe fine d’un stylo en métal, converti pour l’occasion en un efficace poinçon, le prénom d’une petite fille : Estelita.
« Qu’est-ce que vous faites Olivera ? » s’enquit la maîtresse María Julia depuis le tableau noir, à l’autre bout de la classe, en me découvrant en flagrant délit dans mon rôle improvisé d’artisan.
— Rien, mademoiselle, répondis-je rapidement comme par réflexe, tandis que je faisais semblant d’écrire dans mon cahier opportunément laissé ouvert à la page du jour, pour me fournir un éventuel alibi.
— Il me semble que vous, Olivera, vous êtes en train de faire des travaux manuels pendant les heures de mathématiques », glissa avec sarcasme la maîtresse.
Je n’avais cependant pas remarqué l’ironie ; mes compagnons non plus. Mais personne ne douta qu’il s’agissait d’un grave avertissement. Crispée, Mademoiselle María Julia m’ordonna de passer devant et de répéter à toute la classe ce qu’elle disait.
« Allons, Olivera, me pressa-t-elle devant mon absolu désarroi, nous vous attendons ! »
Stupéfait et intimidé par l’ordre menaçant de la maîtresse et les regards compatissants de mes camarades, je me levai et, haussant les épaules, je marchai droit devant – ou, du moins, je pensais que c’était ce que j’étais en train de faire –, comme un condamné à mort qui fait ses derniers pas dans ce monde. Mais je ne sentais pas mes jambes bouger. Je savais que j’étais debout parce que mon angle de vision était différent ; maintenant, par exemple, je pouvais voir Virginia Via au premier rang ; ma cousine Sofia, dont les cheveux blonds éclairaient intensément la salle de classe, assise à gauche, à côté de la fenêtre donnant sur l’avenue ; et à droite, à côté de la porte, seule devant son pupitre, Estelita, encore une fois Estelita. J’avais une vue d’ensemble de toute la classe, donc il n’y avait aucun doute que j’étais debout, mais, comme je l’ai dit, je ne sentais pas mes jambes. C’était comme si je n’avais plus les pieds sur terre, comme si je flottais dans l’espace ; et une partie de cela dut être perçu par la maîtresse parce que, au milieu de cette expérience presque surnaturelle, elle leva à nouveau la voix comme un fusil pointé sur ma tête :
« Olivera, vous êtes dans la lune ? Qu’est-ce que je viens de vous dire ?! Allez au tableau tout de suite », hurla-t-elle si fort que, si j’avais été sur la lune, je l’aurais tout aussi bien entendue.
Quelle déception devait ressentir Mademoiselle María Julia à devoir me réprimander moi, qui appartenait au groupe d’élève le plus acharné de sa classe !
« Olivera, insista-t-elle, je vous le dis pour la dernière fois : soit vous passez au tableau soit vous allez immédiatement chez le directeur. »
J’étais terrifié. Je n’avais aucune idée de ce que je devais répéter devant la classe, puisque durant la dernière demi-heure, j’avais été concentré sur mon bas-relief sur le pupitre que, d’ailleurs, j’avais fini de sculpter juste au moment où la maîtresse m’avait transpercé de son premier cri. Devant la probabilité qu’elle m’envoie chez le Directeur, je pus enfin, peut-être par instinct de survie, sentir à nouveau mes jambes, même si maintenant elles étaient clouées au sol. Je me souviens même avoir pensé que si mes jambes prenaient racines avec la même facilité avec laquelle j’avais été propulsé sur la lune, je ne pourrais jamais exécuter l’ordre de Mademoiselle Maria Julia, ni même la pénitence de me rendre chez le directeur si je n’obéissais à son injonction. Je me précipitai donc avant que mes ongles ne percent la semelle de mes chaussures canadiennes et ne griffent le parquet à la recherche d’un endroit fertile où s’ensevelir. J’allai au tableau aussi vite que possible, tandis que la maîtresse prenait ma place sur mon pupitre et de là, sans bouger, elle me pressa :
« Nous vous écoutons, Olivera ».
Comme on pouvait s’y attendre, son plan pour me faire parler s’avéra un échec total ; mon silence ne pouvait pas être plus hermétique. Elle insista avec le discours propre aux enseignantes quand elles veulent faire peur à un enfant.
« On dirait que vous avez perdu votre langue. Si vous ne répétez pas exactement ce que je viens d’expliquer en cours aujourd’hui, l’école est finie pour vous, Olivera. Vous comprenez ce que je vous dis ? »
Bien sûr que je comprenais ce qu’elle me disait, évidemment que je comprenais. Je transpirais comme un cochon et mourais d’envie de pleurer.
« Et… ? » insista-t-elle de nouveau.
Je crus que c’était la dernière fois avant qu’elle accomplisse sa menace. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Je devais réagir rapidement car sous peu elle me tirerait par l’oreille pour me trainer chez le directeur et ce serait ma fin. J’ai donc commencé à réciter, avec les mêmes paroles, la seule chose que j’avais entendue :
« On dirait que vous avez perdu votre langue, entonné-je avec une naïveté totale, croyant échapper à la pénitence, si vous ne répétez pas exactement ce que je viens…
— Olivera… ! m’interrompit-elle en criant. Chez le directeur ! »
La voix imposante de Mademoiselle Maria Julia franchit les frontières insondables du temps ; j’étais de retour dans le présent, à l’âge adulte, écoutant encore et toujours ses cris, mais à l’abri de ses menaces ; cependant, un autre danger me guettait : celui que mon passé ne s’effondre à partir du souvenir ravivé par ce jour de classe, souvenir que ma mémoire avait jusqu’alors ignoré : le souvenir d’Estelita, de cette petite fille mystérieuse, de cette petite fille oubliée.
Lire son nom sculpté dans le bois du pupitre et voir apparaitre son visage dans la salle de classe, avec Virginia Via et ma cousine Sofia, fut une révélation pour moi, une pièce secrète de mon enfance à laquelle j’avais accédé grâce à l’odeur d’amidon de ma chemise, après avoir erré dans les galeries brumeuses de mon esprit. Estelita ne faisait pas partie de ma mémoire, de cette mémoire fallacieuse qui sélectionne à son goût et à sa convenance des morceaux du passé pour construire le récit tempéré de nos vies ; Estelita faisait partie de mon souvenir, et dans le souvenir il n’y a pas de récit.
La mémoire exige la conscience des faits passés pour pouvoir les raconter ; le souvenir évoque des émotions, des expériences personnelles plutôt que des événements. Le souvenir est ingérable. En lui, il n’y a rien à comprendre ; ce n’est pas comme la mémoire, un artifice de la psyché. C’est pourquoi avoir de la mémoire n’est pas la même chose que d’avoir des souvenirs. Nous faisons confiance à la mémoire. Mais la mémoire est partiale et arbitraire ; sa construction est erratique. De même, elle ne dure pas non plus dans le temps comme les souvenirs, toujours immuables, dont pourtant nous doutons. On dit que notre foyer intime c’est la mémoire. Mais parfois, la mémoire peut aussi être un mensonge. À quel point les fondations de notre foyer sont-elles solides ? L’apparition inattendue d’Estelita, son souvenir jusque-là ignoré, était venue briser les fondations de mon foyer. Qui était Estelita ? Pourquoi l’avais-je oubliée ?
***
La première fois que j’ai vu Estelita, mon père était avec elle, lui tenant la main, devant la porte du garage. C’était un jour de mars et il faisait une chaleur étouffante à Buenos Aires. Mes frères, mes cousins et moi n’étions pas allés à l’école et nous jouions en nous jetant de l’eau avec un tuyau d’arrosage dans la cour de la maison. La petite arriva vêtue d’une blouse bleue, d’une jupe écossaise et de bas bleus qui montaient sur ses jambes maigres jusqu’aux genoux. Elle avait avec elle un petit sac en cuir jaune avec des bords rouges. C’était une belle petite fille, avec une peau très blanche maculée de taches de rousseur. Elle portait une paire de boucles d’oreilles en perles et des cheveux ramassés en deux tresses parfaites qui tombaient sur ses épaules délicates. Elle avait à peine sept ans, tout comme ma cousine Sofia, qui avait quelques mois de moins que moi.
Son arrivée ne fut pas une surprise pour moi durant cette chaude après-midi. En fait, j’attendais Estelita avec beaucoup d’anxiété. La veille, mon père avait réuni toute la famille autour de la table en granit construite à l’ombre d’un Damas dans le jardin – il nous convoquait toujours dans ce lieu isolé et inhospitalier de la maison quand il voulait nous dire quelque chose de capital, comme si les autres dépendances, corrompues par la vie quotidienne, ne pouvaient servir à telle intention –, là, il nous annonça sa décision : le lendemain, vers midi, il viendrait enfin avec elle.
Il y avait quelques semaines de cela, le sujet avait déclenché une vive dispute entre mes parents. Maman s’était opposée à ce qu’Estelita vive avec nous.
« Nous avons assez à faire avec quatre garçons pour en plus devoir prendre en charge une fillette », avait-elle argumenté.
Je n’avais de contact avec les filles qu’à l’école. Là-bas, le seul territoire qui était interdit aux garçons était les toilettes des filles ; à la maison, évidemment, il n’y avait pas de toilettes pour filles. « Comment va faire Estelita ? », me demandais-je. Même si je ne le verbalisais pas, je donnais raison à ma mère.
« Elle dormira dans le salon », déclara mon père.
Je n’avais pas conscience que les filles devaient avoir leur propre chambre. Et il n’y avait pas non plus de « dortoir » réservé aux filles. Mes frères et moi étions répartis par paires dans deux chambres : "les grands" dans celle, petite et lumineuse, qui avait naguère été la cuisine ; et "les petits" (j’étais l’un des deux), dans la plus large, carrée, sombre, sans fenêtres et avec de nombreuses portes.
« Estelita est une petite fille, m’inquiétais-je, elle ne peut pas dormir avec les garçons ».
« Je ne parle pas de ça, Joaquin. Une fillette de six ans peut bien dormir avec les petits dans leur chambre ce n’est pas le problème ; ce n’est pas cela qui m’inquiète », répondit ma mère à son mari, sans donner d’autres indices.
Mes grands-parents, qui vivaient à la maison, n’aimaient pas non plus l’idée qu’Estelita vive avec nous, mais ils n’avaient pas leur mot à dire. Ils connaissaient le caractère irritable de mon père, leur fils unique, et évitaient de le contrarier.
« Bien, si tu le dis pour l’argent, c’est réglé : au collège, on m’a promis que j’aurais plus d’heures de cours », avait répondu notre père, à la limite de perdre patience, à son épouse.
Il était un homme habitué à se réserver le dernier mot sur tous les sujets qui l’intéressaient et personne n’osait le contredire. Quand il parlait, tout le monde se taisait ; et ce qu’il disait était définitif comme la mort. Ses dialogues étaient des monologues. Il ne s’intéressait pas à ce que les autres pouvaient dire, il voulait juste que les autres l’entendent. C’était comme ça avec les cadets du Collège militaire où il donnait des cours de je-ne-sais-quoi, c’était comme ça avec les fidèles de la paroisse où il officiait comme diacre et c’était comme ça avec ma mère.
« Ce n’est pas non plus ce qui m’inquiète, Joaquin », persista-t-elle à ce moment-là, ennuyée.
Elle allait dire : « Tu sais de quoi je parle, Joaquin, ne fais pas l’idiot », mais elle ne le fit pas. Jamais elle n’aurait osé parler ainsi à son mari ; celui-ci l’aurait battue ; il l’avait déjà fait une fois, dans l’intimité de leur chambre. Mon frère aîné avait tout entendu derrière la porte : les insultes, les coups, les pleurs, puis un silence angoissant.
« Et qu’est-ce qui te « perturbe », si on peut savoir ? » l’interrogea-t-il, supposant que sa femme ne terminerait pas sa phrase ; il était évident qu’elle ne désirait pas parler de l’affaire devant ses enfants.
Quelques jours plus tard, malgré l’opposition de ma mère, la décision fut entérinée.
« Demain vers midi, je viendrai avec Estelita, nous informa mon père assis à la table de pierre du jardin. Au début, elle dormira sur le canapé du salon, ensuite on verra. »
Il fit une pause lourde de sens et, subitement, il décréta :
« Et on n’en parle plus. »
Cette dernière phrase s’adressait sans aucun doute à Maman, bien qu’à aucun moment il ne l’ait regardé dans les yeux. Elle gardait le silence et n’avait pas besoin de parler. La gravité de son visage disait tout.
« Nous aurons une sœur », s’écria un des « grands », le cadet, toujours prêt à dédramatiser les situations tendues par un commentaire frivole.
« Ils auront une cousine, rectifia, avec sérieux, mon père, une cousine qui vient de la campagne ».
En entendant cela, – que Estelita était une cousine de la campagne – mes inquiétudes sur l’endroit où elle allait se soulager et celui où elle allait dormir disparurent soudainement ; je savais qu’entre cousins il n’y avait pas de gêne. Ma cousine Sofia, par exemple, dormait dans ma chambre et utilisait les mêmes toilettes que moi quand elle restait à la maison.
Finalement, mon père s’adressa à maman :
« En fait, chérie (ce « chérie » n’avait rien d’affectueux, il était plutôt péjoratif), quand j’arriverai demain avec Estelita, je veux que les enfants de ta sœur soient là aussi », lui ordonna-t-il.
Le lendemain on aurait école, lui rappela ma mère.
« Qu’ils manquent l’école, résolut-il soudain, qu’ils restent à la maison avec leurs cousins à jouer au carnaval. Beaucoup d'enfants jouent au carnaval..., ajouta-t-il, de façon réfléchie. Y aurait-il une image plus heureuse à offrir à cette petite quand elle viendra demain ? »
C’était une question rhétorique. Tout ce que maman pouvait répondre était sans intérêt pour lui.
Peu après son arrivée, après qu’elle eut été baptisée "d’urgence" par un aumônier ami de mon père, Estelita alla à l’école avec ma cousine Sofia et moi-même. Nous étions tous les trois dans la même classe. Et cela ne prit pas longtemps avant qu’elle ne dépasse les autres élèves. Ses notes étaient exceptionnelles et la maîtresse María Julia en était ravie ; elle la prenait toujours en exemple. « Tu devrais apprendre de ta cousine Estelita », me grondait-elle, non sans affection, chaque fois que je faisais une bêtise. Estelita s’était, en effet, forgée une telle réputation de petite fille intelligente et appliquée que l’enseignante pensait avoir découvert un génie parmi ses élèves.
La rumeur qu’il y avait une fille surdouée à l’école se répandit si vite que les autres enseignantes commencèrent tout à coup à voir ma cousine de la campagne de manière spéciale, avec un mélange d’admiration et de respect. « C’est une petite fille brillante », répétaient-elles à ma mère jusqu’à épuisement, à la sortie de l’école. Et je n’avais pas de camarade qui n’aimait pas Estelita. Même Sofia avait été reléguée à un décevant second rôle – décevant pour elle bien-sûr – dans les petites listes que mes amis faisaient des filles les plus belles de la classe.
Dans le quartier, sa popularité n’était pas moindre à celle de la classe, ce qui donnait lieu à des commérages. « C’est la cousine des garçons, mais pas la fille de la sœur de sa mère », les vieilles pies qui connaissaient la généalogie de toute notre famille causaient.
Le boulanger n’était pas non plus à la traîne avec sa curiosité. Il s’appelait Victor et il avait mauvaise réputation à la maison. Il avait une barbe si sombre et touffue que s’il avait décidé de se raser, personne n’aurait pu l’identifier comme le même homme que, tous les matins, on voyait derrière le comptoir. « Je n’aime pas du tout cette barbe », avait dit un jour ma tante à maman alors qu’elles buvaient le maté dans le patio. « Tu penses qu’il est mêlé à quelque chose de bizarre ? », lui avait répondu maman, de façon innocente. « Je suis sûr que la barbe est un camouflage », avait poursuivi ma tante. « Alors la boulangerie est une couverture ?! », avait aventuré ma mère. « Bien sûr, Graciela. Tu ne te rends pas compte ! », s’était exclamée sa sœur. Maman ne se rendait pas compte de grand-chose. « Tu n’as pas vu que dans la petite pièce de derrière il y a toujours un tas de gens qui vont et viennent à n’importe quelle heure ? Tu ne vas pas me dire à moi, Graciela, qu’ils font du pain », conclua-t-elle.
« Quel âge a cette petite beauté ? voulut savoir un jour le boulanger.
— Sept ans », répondit, Estelita elle-même, devant la perplexité de maman et à la suite de son long silence.
Maman était encore absorbée par ses pensées. Peut-être se repassait-elle dans sa tête les mots imprudents de sa sœur au sujet de cet homme qui venait maintenant la déranger avec ses questions indiscrètes. Moi-même, en fait, je me rappelais avec frayeur ce que ma tante avait dit de lui – même si je ne l’avais pas compris. Le ton qu’elle utilisait pour le dire m’avait suffit.
« Et comment tu t’appelles ? s’adressa-t-il maintenant à ma cousine, afin de poursuivre son enquête.
— Estelita », répondit promptement maman, en se réveillant de sa léthargie.
Estelita resta quelques mois de plus à la maison sans que son séjour, entouré de rumeurs, n’atteigne une année. Mon père l’emmena en voiture, un matin de février, Dieu-sait-où et on ne la revit plus jamais. Elle portait ce jour-là les mêmes vêtements qu’à son arrivée : blouse bleue, jupe écossaise et bas bleus ; elle tenait aussi son petit sac jaune avec des bords rouges et avait encore sur elle ses boucles d’oreilles à petites perles rosées serties d’or.
Dans ma famille, on ne parla plus d’elle, comme si rien de tout ce dont je me souviens aujourd’hui – malgré ma mémoire – n’était arrivé, comme si Estelita était un fantôme. Maman gardait une photo où l’on voyait ce fantôme, néanmoins, avec netteté. C’était la seule photo qui gardait une trace de l’existence de cette fillette dans nos vies. Estelita était souriante sur cette photo prise durant la célébration du 80e anniversaire de ma grand-mère maternelle. Derrière l’image, une date écrite au crayon, à peine lisible : 22 avril 1977. Estelita n’était pas un fantôme, mais qui était Estelita ? Avec tous ces souvenirs retrouvés, je suis allé voir ma mère.
« Pauvre Estelita, dit avec pitié maman, quand je lui transmis mes inquiétudes. Elle croit encore que vous êtes ses cousins ».
C’était la première fois qu’elle m’en parlait. Aujourd’hui, mes frères et moi sommes adultes ; et nous n'ignorons pas qu'Estelita n’est pas notre cousine, mais nous n'en savons pas plus.
« Comment tu le sais ? interrogé-je ma mère.
— Isabelle me l’a dit il y a quelques années, me répondit-elle en prenant son temps.
— Isabelle ? demandé-je confus. Ton amie Isabelle, la fille du Colonel Garrido ?
Ma mère hocha la tête sans dire un mot, fermant les yeux. Puis, après quelques longues secondes, elle précisa :
— Elle m’a dit qu’elle avait épousé un paysan et qu’elle était partie vivre avec lui à San Vicente. »
J’ignorais complètement qu’il y avait un lien entre Estelita et l’amie de maman.
— Mais Isabelle connaissait Estelita ?
— Elle la connaissait d’avant qu’Estelita ne s’appelle Estelita… », me répondit maman.
La mémoire est construite avec des souvenirs, progressivement, comme s’il s’agissait d’un puzzle. La mémoire est un puzzle du passé et les souvenirs sont les pièces de ce puzzle. Mais si, comme on le dit, nous connaissons du passé seulement ce qui est dans notre mémoire, le reste, ce que nous ignorons ou oublions du passé, nous pouvons seulement le soupçonner. Les souvenirs seraient alors les soupçons de ce passé, avant que nous ne puissions leur donner un sens en les assemblant comme les pièces du puzzle. Mais nous n’avons jamais fini d’assembler le puzzle ; il y a toujours de nouvelles pièces qui apparaissent, des souvenirs cachés qui un beau jour se présentent sans crier gare – la mémoire est un acte volontaire, pas le souvenir – ; et qui nous obligent à reconstruire la mémoire, en actualisant notre histoire. Estelita était une pièce manquante, peut-être « la » pièce manquante, dans le puzzle de mon enfance.
FIN
Entamez un dialogue : écrivez-lui à notre adresse decameron2020@albiana.fr, nous lui transmettrons votre message !


















