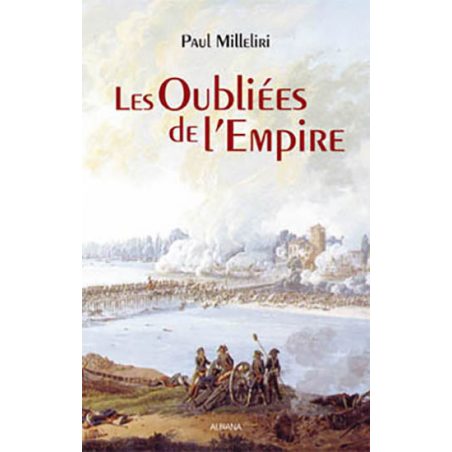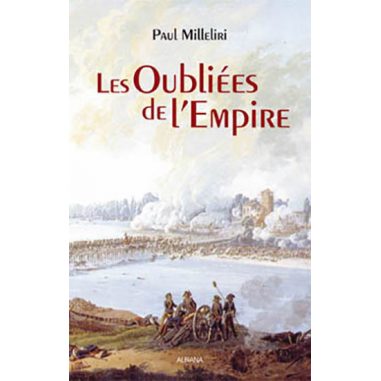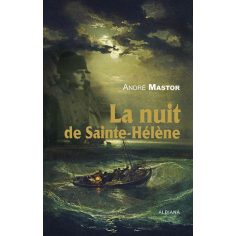Quatrième de couverture
Dans ce premier roman magistral, Paul Milleliri nous entraîne sur les traces de ceux qui, loin des lambris de l’Empire, vécurent l’épopée napoléonienne de l’intérieur, soldats et petites gens de nos régions pris au piège de l’Histoire en marche. Un viol, une soldatesque sans foi ni loi, un désir de rendre justice aux morts, la Révolution, l’envol de l’Aigle et ce sont des vies entières qui basculent et, suivant le cours chaotique des événements politiques et militaires, tracent les linéaments d’une époque convulsive.
Les protagonistes sont issus de la petite île natale de l’Empereur, héros et anti-héros face à leur destin, ballottés par le vent fou qui balaye l’Europe. Une mère et son fils, un fils de famille paraplégique et son cousin soldat entrecroisent ici leurs lettres qui décrivent l’évolution de leurs propres vies et les grands événements auxquels ils participent. La fresque épistolaire superbement maîtrisée plonge alors le lecteur dans les méandres d’un roman multiforme, envoûtant, jusqu’à la résolution de l’intrigue en forme de leçon de vie. À travers les vicissitudes, devant l’adversité, les hommes mènent leurs vies entre gloire et misère et, parfois, deviennent meilleurs et se détournent des torrents du sang.
Extrait
Bonifacio, 20 ventôse An II
Caru figliolu,
Depuis que trois malfaisants ont ruiné notre famille comme leurs semblables ont ravagé le Boscu de San Franzé, ta lettre a été le premier rayon de soleil à entrer dans notre maison. Mais ce n’était qu’un soleil d’hiver et dans mon cœur tendu de deuil il n’a pu y déposer la joie.
Toutes les mères sans fortune rêvent de jours meilleurs en allaitant leur fils. C’est vrai Saveriu, j’avais rêvé pour toi d’un autre avenir. Ma in casa nostra c’è canzata a piena. Chi fà ? Soga era to destinu…
Si tes trois frères aînés avaient survécu à la fièvre des marais, les choses en seraient allées tout autrement. À la mort de ton pauvre père, tué par la malmignatta en travaillant aux foins dans la vallée de l’Ortolo, tu es devenu l’homme de la maison. Chez nous, l’affront demande le sang. Et le sang tu le sais comme moi appellera le sang. Il fallait sauver l’honneur de notre casata. Toccai à tè. Tu n’avais que quinze ans et pourtant tu as fait ton devoir. Comment pourrais-je te le reprocher ? Ici, de la plage à la montagne, tout le monde t’a compris et te tient en estime. Bien sûr, la maréchaussée est venue enquêter chez nous. Mais il n’y a rien à attendre de la justice française.
Au reste, dans la nuit du 18 au 19 février tous les soldats ont embarqué vers la Maddalena. Aucun n’a été inquiété. Ringraziandu à Diu nous avons aussi des amis. J’ai pu savoir que les assassins de notre petite Maria Nunziola n’étaient pas des Marseillais. On m’a dit qu’il s’agissait d’hommes du onzième bataillon corse de Colonna Cesari. Ils sont Ajacciens. L’un, le plus dangereux, est un caporal du nom de Bartomeo Francesconi, dettu « sei ditti ». L’autre serait un certain Lazaru Lambruschini.
Saveriu, mon fils, il me reste encore à t’apprendre une terrible nouvelle… »